Exode 34,29 est sans doute le verset biblique
qui a influencé l’histoire de l’art comme aucun autre
texte de la Bible, puisqu’il est à l’origine de la
représentation de Moïse avec des cornes. S’agit-il
simplement d’une erreur de traduction comme on le dit souvent?
Ou faut-il réhabiliter les cornes de Moïse?
Le récit du veau
d’or, dans le chapitre 32 du livre de l’Exode, peut se lire
comme une réflexion sur la difficulté, voire l’impossibilité,
d’accepter un dieu invisible, transcendant, ne supportant aucune
représentation. Lorsque le peuple d’Israël était
arrivé au désert du Sinaï, Dieu lui avait promis
qu’il pourrait devenir un peuple de prêtres (Ex 19), c’est-à-dire,
un peuple où il n’y a pas besoin de clergé, puisque
chaque fils d’Israël est son propre prêtre. Luther s’est
d’ailleurs appuyé sur ce texte pour sa conception du sacerdoce
universel. Cette promesse se réalise, en effet, en Ex 24 où
des adolescents offrent des holocaustes, ce qui est normalement un privilège
des prêtres. Auparavant, Dieu avait communiqué au peuple
le Décalogue qui s’ouvre par l’interdiction de se représenter
le divin. Mais, lorsque Moïse s’absente pour recevoir de la
part de Dieu les tables de la loi, le peuple ne supporte plus d’avoir
affaire à un dieu invisible et Aaron lui fabrique un veau –
expression ironique pour un taureau – en or. Cette transgression
originelle met fin au statut particulier d’Israël (en comparant
Ex 32 avec Gn 3, on constate que les deux récits sont construits
de manière parallèle: le veau d’or est pour Israël
ce que la «pomme» est pour l’humanité).
|
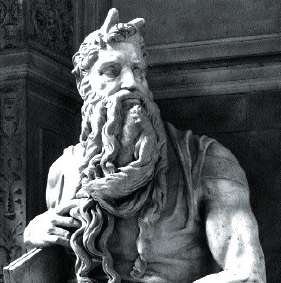
Moïse de Michelangelo à
l’église de Saint-Pierre-aux-Liens à Rome
|
Après avoir détruit le taureau, qui est
un symbole courant au Levant pour les dieux de l’orage, les Lévites
sont installés comme une caste à part, et Israël
devient un peuple comme les autres, avec un clergé qui s’occupe
des sacrifices. Moïse monte alors de nouveau vers Dieu pour obtenir
le renouvellement de l’alliance. Lorsque Moïse redescend pour
instruire le peuple, il n’est plus le même: «Quand
il descendit de la montagne, il ne savait pas, lui, Moïse, que
la peau de son visage était devenue rayonnante en parlant avec
le Seigneur.» Cette traduction de la TOB correspond à la
plupart des traductions du texte hébreu dans les langues modernes;
cependant la traduction latine n’avait pas compris «rayonnant»
mais «cornu», et se trouve ainsi à l’origine
d’un motif qui se retrouve à travers toute l’histoire
de l’art, du Moyen Âge jusqu’à nos jours.
Les commentaires et d’autres études expliquent
souvent que toute cette idée de cornes est exclusivement liée
à une mauvaise interprétation du texte hébreu.
Mais ceci n’est pas vraiment sûr. Il me semble, au contraire,
que le récit hébreu joue sur l’ambiguïté:
le verbe «qaran» peut en effet signifier «rayon-ner»
ou «être cornu». Donc pour un auditeur hébreu
les deux significations se mélangent. La sensibilité à
cette ambiguïté se retrouve notamment chez Marc Chagall,
qui présente les «cornes» de Moïse comme des
rayons lumineux. Les cornes symbolisent la force et sont souvent des
attributs divins. Mais dans le contexte du récit du veau d’or,
il y a peut-être un sens encore plus profond. Le peuple voulait
un dieu visible; ce faisant il a provoqué la «transgression
originelle d’Israël» et la destruction de cette image.
Au moment de l’alliance renouvelée, Moïse apparaît
avec des «cornes». A-t-il pris la place du taureau? D’une
certaine façon, c’est le cas, puisqu’il est, lui, le
médiateur visible entre Yahvé et Israël. Il n’est
certes pas la représentation du Dieu d’Israël, mais
il demeure définitivement son meilleur représentant. Ainsi,
les cornes expriment le statut tout à fait particulier de Moïse.
Ce faisant, l’auteur d’Ex 34,29 fait preuve d’une grande
audace puisqu’il transpose des attributs du divin sur un homme.
Il exprime par là une conviction profonde qui caractérise
à la fois le judaïsme et le christianisme. Pour ces deux
religions, Dieu se manifeste dans la rencontre avec d’autres hommes.

Thomas
R�mer


![]()