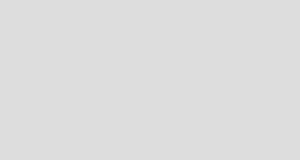« Quand je dis Dieu… », qu’est-ce qui me vient à l’esprit ? Qu’est-ce que j’imagine ? Qui est Dieu pour moi ? À quoi ou à qui je pense ? Voici le premier texte d’une nouvelle série à découvrir.
Quand je dis Dieu, de quoi ou de qui je parle ? Cette question s’impose d’emblée. Elle traverse une existence humaine avec ses hauts et ses bas, une histoire personnelle parfois chaotique. Dieu implique la foi, la foi appelle Dieu. Ils s’appellent réciproquement. Ils forment un couple inséparable. La foi se présente comme une réserve, une provision mise en danger par les épreuves, les déchirements et les désillusions où l’existence s’alourdit sous la pesée du mal.
Cependant Dieu est comme une parole secrète, une poussée intime qui nous entraîne aux confins du Royaume. Nous sommes constamment au bord de l’ineffable, au bord du silence de l’expérience mystique. Celui dont je parle n’a pas de nom qui lui soit propre. Et surtout Dieu n’est pas un nom, mais un verbe dans la nudité de son énonciation.
Quand le Dieu biblique se présente et s’annonce, au buisson ardent, il déclare à Moïse : « Je suis celui qui dit : Je suis », ou encore : « Je suis qui je suis. » Ou encore d’après l’Apocalypse : « Je suis Celui qui est, qui était et qui vient. »
Ainsi Celui dont je parle est l’advenir, le devenir, le verbe par excellence.
Le Règne, le Royaume, l’Évangile, c’est cette force personnelle et transpersonnelle qui me fait dire : « Elle vient m’enthousiasmer. » Dans son origine grecque, l’enthousiasme, c’est ce qui nous anime d’un transport divin. Cette poussée intérieure nous transporte au-delà de nous-même et au-delà de tout.
Inlassablement me revient en tête cette phrase des Confessions d’Augustin d’Hippone : « Tu étais plus intérieur que mon intimité, plus élevé que mes sommets. » Cette intimité et cette élévation comportent au moins trois modalités.
La première fort paradoxale : cette présence divine nous habite par son absence. C’est l’inscrutable, l’indicible, l’insondable incompréhensible. On retrouve ce paradoxe dans la célèbre prière attribuée à Grégoire de Nazianze (IVe siècle). Il invoque en effet cette présence divine en disant : « Ô Toi, l’au-delà de tout. » Cette expression signale l’indépassable. Mais en même temps il maintient un relation personnelle par cette simple invocation : « Ô Toi ». L’humble prière brave cette contradiction et accomplit l’impossible.
Deuxième modalité : Dieu se signale par des traces chez les autres, en dehors de mon intériorité et d’abord chez Jésus de Nazareth, chez les mystiques, en Islam, en toute tradition religieuse et dans la Bible. Traces variées, éclatantes et permanentes.
Troisième modalité : Je constate en moi, en ma secrète intériorité la présence douloureuse d’un vide et aussi l’heureuse intuition d’une plénitude. Un mouvement intérieur me pousse à viser à la fois plus haut et plus profondément. L’être humain, c’est quelqu’un qui dépasse sa condition mortelle et malheureuse. Il dépasse la foi de son enfance, l’athéisme de son adolescence. Il prend alors le risque de vivre en Dieu très librement.
Quand je dis Dieu, je dis communion.
Pour faire un don, suivez ce lien
 Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté
Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté