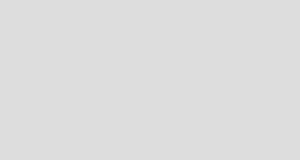C’est un petit ouvrage, en latin, noyé dans le vaste corpus des oeuvres de Calvin. Réponse aux questions et objections d’un certain juif (un rabbin du XIVe siècle identifié très récemment) paraît en français, traduit et commenté par Marc Faessler. Dans cet entretien avec Antoine Bosshard, Marc Faessler insiste sur la singularité de ce texte un peu oublié.
Pourquoi pensez-vous que Calvin jugeait nécessaire de répondre à ce rabbin du XIVe siècle ? En dépit du langage polémique qui est le sien, au-delà de l’apologie du christianisme, est-ce que le Réformateur ne cherche pas à tenir un discours plus ouvert et sensiblement différent de celui de l’Église catholique ?
Il s’agit d’une réelle ouverture, car le Réformateur croit à la force de la Parole prophétique hébraïque. Pour lui, l’adoption d’Israël par Dieu – je préfère ici le mot « adoption » à celui d’« élection », car il marque qu’à travers le judaïsme, toute l’humanité est adoptée – est irrévocable.
Il faut dire que Calvin fait, autour des années 1530- 1533, une expérience décisive. Il s’apprête à devenir un grand humaniste, comparable sans doute à Érasme, quand il passe par une conversio subita, comme il le dit lui-même, formulation qui a fait couler beaucoup d’encre. À mon avis, il fait à ce moment-là une découverte fondamentale : comme humaniste, comme commentateur de Sénèque, par exemple, il en restait à l’immanence du texte, de sa rhétorique, de son langage, de sa syntaxe. Sa conversion tient à ce qu’il découvre soudain le texte biblique comme advenue de la Parole, langage devenant adresse venue d’ailleurs – de la Transcendance. Ce retournement l’amène alors à écrire L’Institution de la religion chrétienne, dans laquelle le texte biblique, celui de la Bible hébraïque comme celui du Nouveau Testament, est une constante advenue de la Parole.
Exactement, c’est l’élévation du langage à son statut prophétique, à sa capacité de dire plus qu’il ne dit : c’est du moins ainsi que je l’entends. Ainsi, Calvin prend très au sérieux la Bible juive comme lieu de cet événement. Et le premier acte fondamental, ici, c’est l’adoption, par Dieu, du peuple d’Israël, qui se matérialise par le don de la Torah et du Décalogue. À la différence de l’Église catholique, Calvin pointe l’importance de la Loi, aime rappeler ici que les Dix commandements sont les Dix Paroles. Dix Paroles qui, mieux qu’un texte de tonalité législative, ouvrent des horizons importants pour l’existence de chacun. Chacune des Paroles aborde un pan de l’existence ; elle ne résout pas tout, car la vie est bien plus compliquée que cela ! Mieux qu’un ensemble d’impératifs, les Dix Paroles sont des propositions ouvrant l’accès à la sainteté. De surcroît, je relève, dans un commentaire de cette traduction, que Calvin établit plusieurs niveaux dans les lois du judaïsme : cela aussi est extrêmement nouveau.
Disons que le Réformateur, dans sa Réponse, se demande comment il se fait que ceux qui ont été adoptés par Dieu n’entendent pas la parole du Nouveau Testament. Et si l’on suit la ligne des questions posées par le rabbin qui conteste la réalité de l’incarnation, on constate que les réponses de Calvin débouchent sur une christologie de la kénose – entendez l’abaissement du Christ. Là, poussé dans ses derniers retranchements, Calvin se doit, s’il veut affirmer la transcendance de Dieu sur la Croix, d’expliciter le sens de ce retrait de Dieu en Christ dont parle la Lettre de Paul aux Philippiens (2,1-11).
En résumé, la Réponse jette un pont vers le judaïsme ?
Absolument. Par le rappel de l’adoption du peuple juif, et avec lui de toute l’humanité ; par le rappel de l’importance des dix Paroles ; mais aussi par une notion très importante, chez Calvin, celle de figure : la Bible juive offre des figures inspiratrices. Ainsi quand Calvin va fonder et organiser l’Église, il puise dans la manière dont Israël, lui-même, s’est organisé : Moïse, par exemple, s’entoure d’Anciens, le Réformateur, pour son Église, fera de même. Comprenez bien qu’il s’agit moinsde reproduction des figures tirées de l’Écriture que de leur transposition dans le monde moderne, celui de la Renaissance.
Votre lecture de la Réponse ne souligne pas seulement l’ouverture de Calvin, mais son « impensé » . Qu’entendez-vous par là ?
Je désigne ainsi ce qui n’est pas venu à sa pensée ! Il ne comprend pas ce que signifie le refus opposé par Israël au Christ-Messie. Comme saint Paul, il attend la conversion d’une partie des juifs à la fin des temps, mais ne saisit pas ce que ce refus d’Israël a de positif, déjà maintenant, car ce refus peut être compris comme retenant le christianisme de retomber dans l’idolâtrie : celle de l’image, des pouvoirs, du magique.
Prenez le cas de la querelle des images : dans le judaïsme, une des dix Paroles demande qu’on ne se fasse pas d’image de Dieu. Certes, Calvin prend ce commandement au sérieux, et on le lui a assez reproché ! Mais ce qu’il ne voit pas, c’est que le judaïsme lui rappelle, par sa fidélité à ce commandement, quelque chose de fondamentalement positif. Un même horizon de promesse existe entre judaïsme et christianisme. Les juifs attendent encore, et, dans cette attente, manifestent l’absolue transcendance de Dieu. Les chrétiens attendent toujours, en témoignant de l’accompagnement incarné que Dieu offre aux humains. Voilà qui pourrait ouvrir une autre voie dans le dialogue entre judaïsme et christianisme. Ces deux horizons sont complémentaires et non antagonistes.
Calvin toutefois n’a pas pu éclairer les raisons pour lesquelles le peuple juif a été persécuté à ce point par le christianisme. Il montre, dans ce texte, une réelle compassion pour les souffrances du peuple juif. Mais il est freiné par des notions fort lointaines pour nos contemporains et ne parvient pas à sortir de la pensée de la Providence, qui fait appel à des catégories très aristotéliciennes. De ce fait, il ne parvient pas à penser le malheur des juifs comme la responsabilité des chrétiens. Il se borne à constater que leur peuple reste enfermé du côté de la réprobation et de la vindicte divine.
Un des traits surprenants de cet ouvrage, c’est tout de même la vigueur incroyable du langage employé par Calvin pour s’adresser aux juifs : « insensés », « chiens corrompus », « chiens pervers », « porcs »… Un vocabulaire qui contraste avec sa capacité de saisir l’héritage judaïque…
C’est exact. Mais comme le montre Claude Postel dans une étude sur les invectives au temps de la Réforme (voir note ci-dessous), il s’agit d’un phénomène d’époque. Une époque violente, où l’on risquait sa vie : Calvin, pour cette raison, n’a plus pu quitter Genève depuis 1541. En revanche, je note qu’il ne traite jamais les juifs de verpus, de « circoncis ». Car à ses yeux, la circoncision est l’équivalent du baptême. Le sacrement, là, n’a pas du tout la signification que lui donne le catholicisme : il est un des signes qui nous disent l’adoption de Dieu.
Résumons. La Réponse de Calvin, dites-vous, est susceptible d’entrouvrir le dialogue avec le judaïsme. En quoi ?
Par la notion d’adoption, d’adoption irrévocable du peuple juif. Calvin en fait le noeud de notre inclusion dans la Révélation. Autre lieu de cette proximité : le Décalogue, qui, à ses yeux prend la forme d’un contrat d’alliance de l’adoption divine. Le Décalogue est l’apport indépassable du judaïsme à la culture universelle, que le calvinisme nous incite à mettre en avant. Autre thème appelant au dialogue : la kénose, cette humilité, cette toute-faiblesse, par laquelle passera le Christ sur la croix – vérité de toute vie humaine, de toute pensée, de toute détresse – appelée à se ressaisir, à ressusciter. Comme Calvin le montre lui-même, c’est un thème présent dans Ésaïe 53 (« Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance… »). C’est enfin ce que je nomme la Transcendance messianique, présente dans la parole prophétique de la Bible juive, de même modalité que celle qui se fait jour dans la révélation du Messie chrétien. Autant de thèmes qui, au-delà de la virulence du ton employé par Calvin, nous permettent d’envisager autrement notre relation au judaïsme.
(propos recueillis par Antoine Bosshard)
Jean Calvin, Réponse aux objections d’un certain juif, traduit du latin, présenté et commenté par Marc Faessler, Labor et Fides, 2010. (Pour chacune des 23 questions, Faessler explicite la question juive, reprend l’objection de Calvin au nom de la Bible juive, déploie la réponse chrétienne et relève l’impensé dans la réponse de Calvin.)
Pour en savoir davantage :
Catherine Chalier et Marc Faessler, Judaïsme et christianisme, l’écoute en partage, Cerf, 2001.
Claude Postel, Traité des invectives au temps de la Réforme, Les Belles Lettres, 2004.
Pour faire un don, suivez ce lien
 Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté
Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté