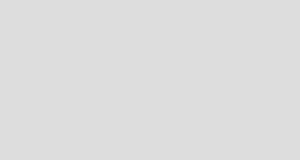Un film récent, « Les Arrivants », raconte le travail quotidien de la Cafda, qui accueille les demandeurs d’asile arrivés en France. Un film essentiel dans notre société qui se referme peu à peu sur elle-même.
Réalisé entre juillet et octobre 2008, ce documentaire de Claudine Borries et Patrice Chagnard montre le quotidien de la Coordination pour l’accueil des familles demandeuses d’asile (Cafda) située rue Planchat dans le XXe arrondissement à Paris. Créée conjointement en 2000 par la Direction de l’action sanitaire et sociale (Dass) de Paris avec la Direction de la population et des migrations (Dpm) et confiée au Centre d’action sociale protestant (Casp), cet organisme financé par l’État est chargé d’accueillir et d’aider des demandeurs d’asile à trouver un hébergement, des repas et constituer un dossier pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) en vue de l’obtention du statut de réfugié.
Les réalisateurs suivent l’assistance administrative et juridique de quatre familles : un jeune couple dont la femme journaliste est enceinte, originaire de Mongolie extérieure, les Wong ; une famille tamoule, un couple et leurs deux enfants, qui a fui le Sri Lanka, les Kaneshamoorty ; une jeune Érythréenne de vingt ans, Zahra, enceinte, qui a quitté l’Éthiopie après avoir traversé le Soudan et fait naufrage en Méditerranée ; et les Muguletha avec leur bébé, d’origine éthiopienne, persécutés pour des raisons confessionnelles. Arrivés par avion, camion ou bateau, les uns et les autres forment le tableau d’une humanité souffrante, confrontée à l’administration et ses directives dans un face à face éloquent avec deux assistantes sociales : Caroline, une jeune femme qui débute dont la posture dominante met mal à l’aise, et Colette, plus expérimentée, qui adopte une attitude maternante et s’évertue à lutter contre les moyens financiers insuffisants et le manque d’effectifs. L’impulsivité de l’une contraste avec la compassion de l’autre. Caroline est très souvent agacée, énervée, par un comportement ou une réponse approximative à ses questions, Colette est quant à elle plus débonnaire et surtout moins angoissée que sa jeune collègue par l’ampleur de la tâche. Toutes deux se heurtent à l’angoisse, la tristesse et souvent la révolte des réfugiés dont l’apaisement ne peut être que provisoire : six mois séparent en effet la constitution du dossier pour l’Ofpra de la réponse de la préfecture.
Comme l’explique André Jacques, secrétaire au service des Migrations du Conseil oecuménique des Églises, en conclusion de son livre Les déracinés : Réfugiés et migrants dans le monde (La Découverte, 1985), les migrants constituent pour les pays européens un triple défi : un défi de solidarité qui nous oblige à prendre conscience que ces différentes communautés ont contribué par leur travail à notre développement et nous incite à soutenir ce qu’elles demandent qui n’est autre que ce que chacun de nous revendique pour luimême : le droit de vivre en paix et dans la dignité ; un défi au droit et à la justice qui impose l’instauration d’une politique cohérente qui sache rassurer, protéger les immigrés et leur permettre de participer pleinement à la vie de la société ; et enfin un défi à la civilisation : à l’ère des échanges internationaux accélérés, de la division du travail et des brassages de populations, le pays d’accueil saura-t-il s’enrichir des apports de cultures venues d’ailleurs, les reconnaître et s’en réjouir au lieu de se replier frileusement sur un passé qui contribue à son dépérissement ?
Au coeur d’une époque où fleurissent le manque de nuances, les amalgames, les clichés et la confusion entre les demandeurs d’asile, les sans-papiers et les clandestins, ce documentaire remarquable et salutaire, tourné sans voix off ni commentaires, nous offre des scènes émouvantes et bouleversantes dont celle filmée au petit matin où l’on voit un homme de ménage laver la salle d’attente de la Cafda où viennent s’agglutiner les migrants, loin de l’obsession de la maîtrise des flux migratoires et des quotas de reconduite à la frontière, dont l’un des murs est orné en lettres mosaïques d’un mot à la fois anachronique et incandescent : Bienvenue.
Pour faire un don, suivez ce lien
 Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté
Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté