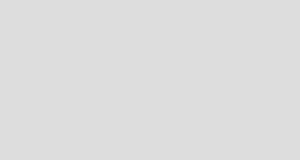Voilà presque cinquante ans qu’André Gounelle participe à la vie d’Évangile et liberté. Il n’a pas cherché ici à écrire un historique de cette période. Il raconte simplement quelques souvenirs.
J’ai écrit mon premier article dans Évangile et liberté en 1966. Le rédacteur en chef en était alors Paul Brunel, pasteur à la retraite à Nîmes, dont je devais faire plus ample connaissance lorsque j’ai été nommé quelques mois après pasteur dans cette ville. Il était respectable et respecté, d’une gentillesse et d’une bonté immenses ainsi que d’un dévouement total, allant jusqu’à l’oubli de lui-même. Il incarnait exemplairement l’image qu’on avait du pasteur à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Son ministère avait eu deux axes principaux : les visites ininterrompues du lundi 14 h au vendredi 18 h et une prédication soignée, dite sans notes (il enlevait le pupitre de la chaire au moment du « sermon »).
S’il avait un goût et une capacité remarquables de contact humain, par contre les méthodes de travail « modernes » lui étaient totalement étrangères. Il recevait des articles (n’en sollicitait jamais), vérifiait qu’ils n’avaient rien d’inconvenant et les envoyait à l’imprimeur en vrac.
Le journal paraissait deux fois par mois. Le président du comité, le pasteur Georges Marchal du Foyer de l’Âme à Paris, exprimait souvent le souhait qu’il rede- Souvenirs d’Évangile et liberté (1966-2003) André Gounelle vienne hebdomadaire comme avant la Seconde Guerre mondiale.
L’imprimeur était un homme âgé ; toute sa vie, il avait édité Évangile et liberté auquel il s’était attaché. Parvenu à la retraite, il avait demandé à son successeur de continuer à s’en occuper. Il publiait les articles sans souci de mise en page, par ordre décroissant de longueur (d’abord ceux qui occupaient le plus de place, puis les plus courts). Personne ne corrigeait les épreuves d’où d’abondantes coquilles parfois savoureuses. Ainsi, un conte de Noël commençait par : « Barrabas avait cinquante ans » ; le texte imprimé donnait : « Barrabas avait cinquante anus » ! Autre exemple : un article parlait du « message puissant » de je ne sais qui (je crois que c’était Marc Boegner, mais je n’en suis pas sûr), ce que le texte imprimé avait transformé en « ménage puissant » !
Le pasteur René Gilliéron, un homme doux, fin, affable, assurait l’administration. Sa voix faible avait nui à son ministère. Sa gestion était artisanale. Il recevait les abonnements et payait les dépenses sur son compte de chèques personnel. Les étiquettes des abonnés étaientimprimées tous les six mois ; entre deux impressions il écrivait à la main les étiquettes pour les nouveaux abonnés et les changements d’adresse. Rayer un abonné était pour lui un crève-coeur ; des gens ont reçu Évangile et liberté pendant des années alors qu’ils ne payaient plus leur abonnement parce qu’il ne pouvait pas se résoudre à les supprimer de sa liste. Des amis bien placés fournissaient au journal quelques publicités payantes, des annonces de complaisance. Là aussi quelques couacs ; ainsi l’annonce du décès d’un pasteur ardent militant de la Croix Bleue a paru entre deux publicités pour du Cognac !
Le pasteur Raoul Lhermet, de Nîmes, féru d’histoire et amoureux de sa ville, faisait fonction de rédacteur adjoint. Son travail consistait à s’occuper de deux numéros par an quand Paul Brunel partait en vacances. Lhermet, qui connaissait bien les milieux journalistiques (il collaborait occasionnellement au quotidien régional Midi Libre) plaidait en vain pour une modernisation du journal.
Il n’y avait pas de comité de rédaction, mais un comité dit de « patronage », présidé par le pasteur Georges Marchal, qui ne se réunissait pratiquement jamais. Quand Marchal demandait à quelqu’un d’en faire partie, il précisait qu’il n’aurait rien à faire : « Votre nom travaillera de lui-même », ajoutait-il.
 En 1967, me semble-t-il (je ne me souviens pas de la date exacte), Paul Brunel, à sa demande motivée par son grand âge, est déchargé du journal. G. Marchal (qui avait consulté quelques amis, mais n’avait pas, je crois, réuni le comité pour en décider) le confie au pasteur Paul Richardot. Ce dernier venait d’avoir un lourd accident de santé qui l’avait contraint à avancer sa retraite. Dynamique, intelligent, souvent caustique, d’un extraordinaire attachement à ses amis (ses amitiés étaient fortes, et, je peux le dire d’expérience, précieuses pour ceux qui en bénéficiaient), il entreprend énergiquement de rénover Évangile et liberté. Il en a une conception très pastorale : « Je voudrais que chaque numéro, disait-il, soit pour le lecteur l’équivalent de la visite de son pasteur. » Il pensait beaucoup aux libéraux qui se sentaient mal à l’aise dans des paroisses et avec des pasteurs « orthodoxes » qui ne correspondaient pas à leurs options et convictions. Il avait le souci de leur apporter, à côté de la réflexion et de l’information, une prédication libérale ; c’était le sens qu’il donnait à l’éditorial, toujours très soigné, qu’il publiait dans chaque numéro (quelques-uns de ces éditoriaux ont été publiés en 1981 sous le titre Hymne à la vie). Les lecteurs devaient pouvoir se sentir liés à une communauté de foi et former une paroisse invisible.
En 1967, me semble-t-il (je ne me souviens pas de la date exacte), Paul Brunel, à sa demande motivée par son grand âge, est déchargé du journal. G. Marchal (qui avait consulté quelques amis, mais n’avait pas, je crois, réuni le comité pour en décider) le confie au pasteur Paul Richardot. Ce dernier venait d’avoir un lourd accident de santé qui l’avait contraint à avancer sa retraite. Dynamique, intelligent, souvent caustique, d’un extraordinaire attachement à ses amis (ses amitiés étaient fortes, et, je peux le dire d’expérience, précieuses pour ceux qui en bénéficiaient), il entreprend énergiquement de rénover Évangile et liberté. Il en a une conception très pastorale : « Je voudrais que chaque numéro, disait-il, soit pour le lecteur l’équivalent de la visite de son pasteur. » Il pensait beaucoup aux libéraux qui se sentaient mal à l’aise dans des paroisses et avec des pasteurs « orthodoxes » qui ne correspondaient pas à leurs options et convictions. Il avait le souci de leur apporter, à côté de la réflexion et de l’information, une prédication libérale ; c’était le sens qu’il donnait à l’éditorial, toujours très soigné, qu’il publiait dans chaque numéro (quelques-uns de ces éditoriaux ont été publiés en 1981 sous le titre Hymne à la vie). Les lecteurs devaient pouvoir se sentir liés à une communauté de foi et former une paroisse invisible.
Son frère, le pasteur André Richardot, organisait des réunions de pasteurs libéraux dans le midi et à Paris (elles en regroupaient une dizaine à Sète, guère plus, je pense, à Paris). En 1965, des laïcs libéraux demandent que ces « pastorales » soient ouvertes aux non pasteurs et deviennent des « journées du protestantisme libéral ». André Richardot, nommé aux Pays-Bas, met en place une petite équipe pour lui succéder et organiser ces journées. Elle comprenait (je ne cite que ceux qui y sont restés le plus longtemps) Jean Chèvre (un expert comptable, qui alliait une forte exigence spirituelle à beaucoup d’humour ; il a publié un délicieux petit livre Le chemin des Garissades dans la collection Alethina), André Ver (un avocat, puis magistrat, généreux, chaleureux, vite indigné), Jacques Sauzède (un ingénieur discret, précis et efficace), Jean-Marc Charensol (pasteur à Marseille) et moi-même (le « benjamin »).
Paul Richardot invite cette petite équipe chez lui à Aix-en-Provence, dans la belle villa qu’il occupait juste au dessus de l’atelier Cézanne. Pendant des années, elle s’y réunit deux fois par an. Sa tâche principale consistait à organiser les « journées libérales », mais Richardot la consulte sur la rédaction et l’organisation du journal. Je garde un souvenir très heureux de ces rencontres où on travaillait, réfléchissait et aussi où on riait beaucoup ensemble dans une atmosphère d’amitié et de confiance mutuelles. Elles avaient lieu du vendredi 19 h au dimanche midi ; on avait assez de temps pour travailler tranquillement et efficacement sans stress. Madame Richardot assurait l’intendance (repas et hébergement) de ces réunions, aidée par sa fille Monique Coulet. Au bout de quelques années, à la fois pour la soulager et pour pouvoir étoffer notre équipe, nous avons décidé de nous réunir dans des maisons qui accueillent des groupes.
À son arrivée, Richardot demande et obtient que le comité de patronage (devenu comité tout court) se réunisse une fois par an à Paris. Il m’y fait entrer, et tous les deux nous faisons le lien entre le groupe parisien et le groupe méridional. Je me souviens de ces réunions au Foyer de l’Âme. J’y ai fait connaissance de François Goguel (secrétaire général du Sénat qui sera plus tard membre du Conseil Constitutionnel), William Seston (professeur en Sorbonne, spécialiste de la Rome antique), Christian Mazel, René Château (pasteurs à l’Oratoire), etc. ; j’y retrouvais Philippe Vassaux et Laurent Gagnebin. Georges Marchal nous éblouissait par son intelligence, son érudition, son esprit et son humour. Sa conversation faisait l’essentiel, en temps et en contenu, des séances. Elles étaient suivies, pour les provinciaux, par un repas à son domicile, boulevard Beaumarchais, où sa femme était particulièrement attentive à ses invités (elle avait tendance – non sans raison – à penser que ce comité réunissait des esprits certes distingués, mais dépourvus de sens pratique et elle se donnait pour mission de veiller sur eux).
Aidé par sa femme, entouré de l’équipe d’organisation des « journées », soutenu par le comité, Paul Richardot réorganise le fonctionnement du journal. Sa fille, Mme Romans, prend en charge avec compétence et conscience l’administration du journal (une vingtaine d’heures de travail par semaine). On ouvre un compte de chèques au nom d’Évangile et liberté, ce qui oblige à se constituer en association régie par la loi de 1901. Grâce au don d’un généreux ami, on achète un « adressographe », machine qui aujourd’hui paraît préhistorique, mais qu’à l’époque les petites publications utilisaient beaucoup. Des campagnes d’abonnements sont entreprises et le nombr e des ab onnés monte régulièrement. Les programmes de la télévision prévoyaient alors un quart d’heure d’expression des associations, juste avant le « journal télévisé ». Nous avons posé notre candidature et en 1977 nous avons obtenu une émission. Elle a été enregistrée par le pasteur Francis Muller, Mme Romans et moi-même. Nous n’avions aucune expérience de la télévision (pour ma part, elle est venue un peu plus tard) et nous avons accumulé les erreurs, celle de préparer des textes et de les lire, celle de vouloir dire beaucoup trop de choses dans un temps relativement court. Nous espérions quelques dizaines de lettres de téléspectateurs ; il y en a eu trois. Je me souviens du dédain des techniciens de la TV pour les provinciaux que nous étions (« Quels sont vos villages ? », nous ont-ils demandé ; nous venions de Lyon, Strasbourg et Montpellier) et du « maquillage » qui était pour moi une nouveauté (« vous pouvez le garder », a dit géné-reusement la maquilleuse à Mme Romans au moment de débarbouiller les « messieurs »).
Paul Richardot mène une véritable politique de rédaction. Il publie des numéros spéciaux, sollicite des articles, en suggère parfois le thème. Il donne de l’élan et du souffle au journal. Il y introduit un peu de couleur ; jusque là tout était imprimé en noir et blanc. À sa demande, l’équipe méridionale rédige le « cartouche » (déclaration de principes) du journal, ensuite retouché et amélioré par le comité parisien. Ce « cartouche » a un succès que nous n’imaginions pas ; il a été repris par les libéraux belges et suisses. Quarante ans après sa rédaction, il continue à paraître dans le carnet en fin de chaque numéro.
En même temps, les liens se renouent et deviennent réguliers avec Le Protestant (le mensuel des libéraux de Suisse romande) ; les deux journaux échangent des articles et lancent en commun des séries sur des sujets bibliques et théologiques ; cette collaboration a préparé l’union actuelle des deux publications. Les relations sont bonnes mais plus épisodiques avec la revue des protestants libéraux belges, Dialogue.
Des problèmes surgissent parfois. Ainsi à la mort du général de Gaulle, un membre du comité qui le connaissait bien, François Goguel, écrit un article qui présente un de Gaulle non conformiste et plutôt de gauche ; il suscite des protestations (venant de gaullistes autant que d’antigaullistes) et des désabonnements.
Une critique assez vive de la procédure d’élections aux synodes de l’Église Réformée de France (à partir de propositions d’une commission des nominations) provoque un communiqué indigné de la conférence des présidents de conseils régionaux. Enfin, certains lecteurs sont choqués par les audaces de Pierre Alause (il signe Pierral) qui aborde des sujets « tabous » (sexualité, contraception, avortement) avec bon sens et humanité, mais dans un langage marqué par son passé de médecin militaire.
 En décembre 1979 (je ne suis pas absolument sûr de la date), la santé de Paul Richardot, depuis longtemps précaire, empire brutalement. Il n’est plus en état de diriger de journal. Sa femme et sa fille assurent encore le numéro de Noël qu’il avait en grande partie préparé et demandent au comité de trouver d’urgence un remplaçant.
En décembre 1979 (je ne suis pas absolument sûr de la date), la santé de Paul Richardot, depuis longtemps précaire, empire brutalement. Il n’est plus en état de diriger de journal. Sa femme et sa fille assurent encore le numéro de Noël qu’il avait en grande partie préparé et demandent au comité de trouver d’urgence un remplaçant.
Quelques coups de téléphones aboutissent à une solution rapide, accueillie avec reconnaissance et soulagement : celle de confier le journal au pasteur Jean-Marc Charensol qui, du temps où il était pasteur à Marseille, avait aidé Paul Richardot. Charensol, très fin et d’une haute culture, un homme attachant, est un spécialiste du Nouveau Testament. Il apporte une tonalité un peu différente, moins pastorale, plus intellectuelle et plus soucieuse d’actualité culturelle. Il introduit des innovations heureuses : en particulier, celle du « cahier » (suggéré, me semble-t-il, par l’avocat marseillais Christian Layec) qui permet de publier dans le journal des textes qui s’apparentent à des articles de revue.
Malheureusement Charensol n’a pas le sens ni le goût de l’organisation. De plus, à la différence de son prédécesseur et de son successeur, il est en activité, chargé d’abord d’une aumônerie d’hôpitaux, ensuite d’une paroisse. À quoi il faut ajouter qu’il a mauvaise santé. Ce qui a des conséquences fâcheuses : le journal paraît irrégulièrement, avec des retards considérables ; une année, le numéro de Pâques parvient aux abonnésaprès Pentecôte ; des conférences ou des concerts sont parfois annoncés plusieurs semaines après avoir eu lieu. D’où une période difficile : les essais (par Laurent Gagnebin, Pierre-Jean Ruff et Christian Mazel) pour seconder Charensol échouent les uns après les autres. Les séances de comité, naguère fécondes et agréables, deviennent tendues. Ses membres ont beaucoup d’amitié pour Charensol et d’admiration pour ses qualités intellectuelles, mais sont très irrités des flottements et du manque de rigueur dans la conduite du journal.
Le départ de Paul Richardot marque, sur d’autres points, un tournant. Il oblige à une réorganisation et entraîne une série de décisions, les plus importantes étant celle d’une rythme mensuel de parution (au lieu de tous les 15 jours) et celle d’une fusion des diverses associations libérales pour créer une « association libérale Évangile et liberté » qui a en charge à la fois le journal et les journées du protestantisme libéral.
De nouveaux statuts et un règlement intérieur sont discutés et adoptés. Sur proposition de Marchal, qui ne désire pas, pour raison d’âge, continuer à assurer des présidences, Laurent Gagnebin est élu président de la nouvelle association et André Gounelle secrétaire général (nous nous entendions très bien et je garde pour ma part un excellent souvenir de ce tandem, malgré les difficultés auxquelles nous avons dû faire face). Le comité parisien et le groupe du midi s’unissent ; du coup le nombre des membres s’accroît, ce qui à la fois enrichit et complique les débats que les présidents successifs (P.-J. Ruff, A. Gounelle et M. Jas après L. Gagnebin) ont parfois de la peine à discipliner. Les séances sont animées, mais moins conviviales, les ordres du jour plus chargés, puisqu’on y traite du journal et des journées, sans compter de sujets annexes souvent délicats. Les questions administratives prennent une place grandissante aux dépens d’une réflexion de fond. La tâche des secrétaires (Pierre et Jacqueline Frey) s’alourdit, mais leurs comptes rendus restent précis et minutieux.
En 1986, Mme Romans ayant souhaité se retirer, M. et Mme Nougarède, des paroissiens de l’Oratoire que C. Mazel connaissait bien et qu’il a sollicités, prennent en charge trésorerie et administration, fonctions qu’ils remplissent avec une ponctualité et une bonne humeur que le comité apprécie beaucoup.
 En 1988, Charensol fatigué, conscient de ses limites et du mécontentement du comité, décide de se retirer. Le pasteur Christian Mazel prend le relais. Très vite, il redresse la situation ; sous sa direction Évangile et liberté paraît sans à-coup, avec une parfaite régularité et une excellente qualité. Le comité retrouve un climat fraternel et serein. Le nombre d’abonnés, stable ou en légère régression depuis des années, recommence à augmenter.
En 1988, Charensol fatigué, conscient de ses limites et du mécontentement du comité, décide de se retirer. Le pasteur Christian Mazel prend le relais. Très vite, il redresse la situation ; sous sa direction Évangile et liberté paraît sans à-coup, avec une parfaite régularité et une excellente qualité. Le comité retrouve un climat fraternel et serein. Le nombre d’abonnés, stable ou en légère régression depuis des années, recommence à augmenter.
Forcément, le journal reflète la personnalité de son directeur-rédacteur en chef. Christian Mazel est vif, alerte ; il joint des intérêts et curiosités multiples à un grand sens littéraire ; il est chaleureux et développe les contacts avec les abonnés (il répond à toutes les lettres) et avec les auteurs d’articles. Il se rend à de nombreuses rencontres (synodes, assemblées du Désert, etc.) pour y représenter le journal. Grâce à lui, Évangile et liberté est entouré par un réseau amical. Sous son impulsion, le journal, tout en restant solide et sérieux, devient plus varié : de courts textes (des citations, des poèmes, etc.) font leur apparition. Ils répondent à un souci précis qu’exprime Mazel dès son entrée en fonction : que dans chaque numéro, tous les lecteurs, ceux qui ont du temps comme ceux qui sont pressés, les intellectuels et ceux qui le sont moins, les jeunes et les plus âgés, ceux qui sont avides de réflexion comme ceux plus sensibles à la spiritualité, les esprits férus de logique et ceux en recherche de poésie trouvent quelque chose qui leur convienne. Mazel introduit des illustrations, en nombre grandissant (1200 entre 1988 et 1993) ; elles viennent tempérer l’austérité de la présentation, mais les trouver ne va pas de soi et demande un gros travail.
Théoriquement, un comité consultatif de rédaction entoure Mazel. En fait, pour des raisons pratiques, ce comité se réunit rarement. Les distances à parcourir à travers la France ont toujours été un problème pour Évangile et liberté ; elles rendent difficiles des rencontres fréquentes et des collaborations étroites. Comme l’avait fait Paul Richardot, Christian Mazel avec sa femme Solange qui joint culture et intelligence à un dévouement et une gentillesse inépuisables, assure presque seul la publication du journal (un gros travail, 50 à 60 heures par numéro). Le pasteur Pierre-Jean Ruff accepte de le soulager, enpartie, en assurant de temps en temps un numéro à thème. L’un d’eux, consacré à l’homosexualité (thème choisi avec l’accord préalable du comité), pourtant équilibré et mesuré, provoque des remous parmi les lecteurs qui le trouvent les uns trop prudent, les autres trop audacieux. Il y a des sujets qui sont toujours difficiles à aborder, tellement ils sont passionnels.
Ces années voient l’arrivée progressive de l’informatique. On achète un ordinateur pour faciliter l’administration, en particulier la gestion des abonnés ; les fiches cartons disparaissent petit à petit. Grâce à M. Nougarède (il n’en est pas allé de même dans beaucoup de petites publications), cette innovation s’opère sans couacs majeurs. De leur côté, Christian et Solange Mazel, avec courage et persévérance, font l’apprentissage, pas toujours facile, du traitement de texte.
Les réunions du comité ont lieu une fois sur deux à Apt, où réside les Mazel, dans un cadre très agréable, confortable et relativement peu onéreux. Avant ou après chaque réunion méridionale, Christian Mazel a l’heureuse idée d’organiser une petite excursion dans cette belle région qu’il connaît bien ; ces brèves escapades touristiques, en plus de leur intérêt propre, contribuent à recréer et à renforcer la convivialité du groupe. J’y ai appris que des moments réussis de « récréation » étaient bénéfiques pour le travail. En 2000, des graves problèmes de santé obligent M. et Mme Nougarède à abandonner, après 14 ans de « bons et loyaux services » leurs fonctions d’administrateur-trésorier. Jean-Pierre Burgelin, retraité à Caussade après une carrière dans les assurances, accepte de prendre la relève (c’est aujourd’hui Étienne Hollier-Larousse qui est trésorier, tandis que la gestion du fichier des abonnés, qu’assurait aussi Jean-Pierre Burgelin, après Mme Romans puis M. et Mme Nougarède, a été confiée à un organisme professionnel).
Fin 2003, C. Mazel, à son tour, se retire. Avec lui, se tourne une page, qui a été belle, de l’histoire du journal et en commence une autre, tout aussi belle. Le 1er janvier 2004, Laurent Gagnebin et Raphaël Picon, avec une équipe qu’ils constituèrent et un projetnovateur, prennent en charge le journal.
 J’éprouve beaucoup d’émotion et reconnaissance quand je pense à tous ceux qui ont participé, pendant ce demi-siècle à la vie du journal. Je ne les ai pas tous nommés, mais tous ont beaucoup apporté et demeurent très présents dans mon souvenir et mon affection. Les relèves, en particulier celles cruciales du rédacteur en chef et de l’administrateur, ont toujours donné du souci, mais toujours des solutions heureuses ont été trouvées. Nous n’avons jamais eu de déficits graves, mais pas non plus des réserves financières abondantes.
J’éprouve beaucoup d’émotion et reconnaissance quand je pense à tous ceux qui ont participé, pendant ce demi-siècle à la vie du journal. Je ne les ai pas tous nommés, mais tous ont beaucoup apporté et demeurent très présents dans mon souvenir et mon affection. Les relèves, en particulier celles cruciales du rédacteur en chef et de l’administrateur, ont toujours donné du souci, mais toujours des solutions heureuses ont été trouvées. Nous n’avons jamais eu de déficits graves, mais pas non plus des réserves financières abondantes.
La vie du protestantisme libéral français durant ces années a largement débordé celle du journal. Mentionnons les « journées » (à Sète, à Agde, puis, aujourd’hui à la Grande Motte), l’association libérale de Strasbourg (qui organise de nombreuses conférences), les paroisses à tendance libérale, l’Université d’hiver (avec sa session théologique annuelle), Alethina (un groupe francophone français, suisse et belge qui a publié pendant une vingtaine d’années des petits livres et organisé des colloques), Théolib (qui, animé par Pierre-Yves Ruff, publie une revue, réédite des « classiques » du protestantisme libéral et a des r encontres régulières), etc.
Il faut citer aussi le travail théologique de quelquesuns d’entre nous. Mais le journal représente, je crois, un élément important, peut-être essentiel, de cette vie. J’espère qu’il continuera longtemps à poursuivre sa mission : établir des dialogues, des échanges ; susciter et soutenir des rencontres ; diffuser des textes de réflexion ; être le porteur d’une spiritualité et d’une pensée à la fois évangéliques et libérales.
Pour faire un don, suivez ce lien
 Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté
Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté