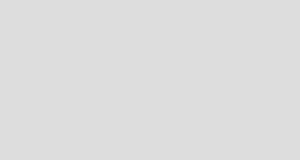La religion que nous pratiquons est-elle la meilleure, voire la seule possible, les autres n’étant alors que des croyances sans valeur et sans intérêt ? Frédéric Fournier montre que la représentation que nous nous faisons de Dieu dépend de notre société, et qu’un enrichissement mutuel des diverses religions est possible.
Pourquoi se poser une telle question ? Il y a quelques années notre société occidentale baignait encore dans une culture chrétienne. Quand on était en recherche spirituelle, c’est à la porte d’une église que l’on frappait. Il y avait un rapport d’identité entre chrétienté et spiritualité. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Le christianisme a perdu son monopole en Occident. En France, les musulmans sont 4 500 000 dont 40 000 convertis, les bouddhistes 600 000. La venue de travailleurs immigrés majoritairement musulmans et l’installation de maîtres bouddhistes Tibétains ont été à l’origine de ce pluralisme religieux en Occident. De plus, les frontières se sont considérablement rapprochées grâce à une certaine démocratisation de l’avion. Les pays à majorité bouddhiste, hindouiste et musulmane sont maintenant proches. Les chrétiens qui, comme moi, ont été en Inde, ne peuvent être que frappés par le foisonnement des temples hindous et par la quasi absence d’églises. Comment Dieu pourrait-il laisser dans l’ignorance spirituelle un milliard d’Indiens ? Assurément être chrétien ne va pas de soi. Quel est le statut des religions non chrétiennes ? Toutes les religions mènent-elles à « Dieu » de manière équivalente ?
Ce que nous appelons Dieu ne peut être connu en soi. Notre existence humaine est conditionnée et limitée par l’espace, le temps et les catégories de l’entendement. Il nous est donc impossible de comprendre Dieu – le tout autre – puisqu’il transcende les limites humaines. Nous sommes dans la situation d’un aveugle qui voudrait décrire exactement ce qu’est le soleil. Pourtant, même si nous ne connaissons pas Dieu, nous en avons des perceptions comme un aveugle qui perçoit le soleil indirectement par la chaleur. Cependant notre appréhension de Dieu est limitée et contingente, liée à notre personnalité et à notre culture.
Prenons l’exemple de M. Dupont, chef d’entreprise divorcé et remarié. Les collègues de cet homme, son exfemme, sa deuxième épouse et son enfant ont chacun une perception particulière de lui. Cette perception ne dépend pas uniquement de l’attitude de M. Dupont mais de la personnalité et des convictions de chacun de ses proches (sur le capitalisme, le divorce…) et du type de relation entretenue avec lui (travail, amitié, amour…). De même, notre perception de Dieu dépend, entre autres, de notre culture ambiante.
Ainsi, représenter Dieu comme un Père a du sens dans une société comme la nôtre qui a été longtemps patriarcale. Dans une société matriarcale, ne représenterait-on pas la divinité comme une déesse mère ? En fait, chaque religion est une perception culturelle et partielle de « Dieu ». Aujourd’hui, personne ne dirait que les planètes tournent autour de la terre, mais que toutes (y compris la terre) tournent autour du soleil. Pour John Hick (théologien anglais), il en est de même pour les religions. Toutes (y compris le christianisme) tournent autour d’un centre qu’on peut appeler par convention « le réel ultime ». Le terme « réel ultime » a l’avantage par rapport à celui de « Dieu » d’inclure les spiritualités non-théistes comme le bouddhisme. Le centre des religions n’est donc pas le christianisme, c’est ce « réel ultime » quel que soit le nom qu’on lui donne : Dieu, Allah, Éveil, Nirvana, Brahman… Toutes les religions sont égales les unes aux autres. Le christianisme n’est ni supérieur ni inférieur aux autres traditions spirituelles.
– mieux connaître l’autre, faire tomber les préjugés réciproques.
– inciter chacun à bien connaître sa propre spiritualité, voire redécouvrir des trésors qu’il avait oubliés.
– s’enrichir les uns auprès des autres. Chaque religion étant relative et en constante transformation, un chrétien a certainement des choses à apprendre dans des domaines non explorés par le christianisme.
L’égalité entre les religions conduit à deux obstacles. Le premier est l’orgueil. Il consiste à croire que « je suis dans le vrai » et que « l’autre est dans l’erreur ». Ce besoin d’écraser l’autre manifeste une peur de la différence et un manque de confiance en soi. L’autre devient effrayant car il risque de remettre en cause mon identité. Mais cet orgueil est aussi le signe d’un désir puéril de toute puissance : toujours vouloir « avoir raison ».
Le deuxième est l’inf luence de la logique aristotélicienne en Occident qui est fondée sur le principe du tiers exclu : « Toute chose est ou n’est pas. » Une telle logique a eu son efficacité pour la science, bien qu’elle semble remise en cause par le concept de réalité de la physique quantique. Mais elle est source d’exclusion. Si l’autre ne pense pas comme moi, l’un de nous deux est dans l’erreur et ce ne peut être que l’autre. Une telle posture de la pensée n’a-t-elle pas permis à l’Inquisition de sévir ?
Mais une autre logique, source de tolérance, existe. Elle est d’ailleurs très répandue dans les pays extrêmeorientaux (depuis le philosophe bouddhiste Nagarjuna). On peut la résumer ainsi, en 4 principes :
Il en est ainsi
Il n’en est pas ainsi
Ainsi et pas ainsi
Ni ainsi, ni pas ainsi
Une telle logique appliquée à la spiritualité est féconde. Le 3e principe permet d’unir des affirmations doctrinales de différentes religions apparemment contradictoires. Cela aboutit à un enrichissement spirituel réciproque. La différence de l’autre, plutôt que d’être combattue, est intégrée dans notre spiritualité. Par exemple les trois monothéismes affirment que Dieu est une personne. Des hindous pensent que Dieu est comme une énergie impersonnelle. Le troisième principe va concilier ces deux affirmations en disant que Dieu est simultanément une personne et une énergie impersonnelle. Le quatrième principe, quant à lui, dit finalement que Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons en dire. Si on reprend l’exemple précédent, Dieu étant tellement indicible, il est au-delà des concepts de personne ou d’énergie impersonnelle.
Affirmer l’égalité de toutes les religions peut se décliner en trois convictions.
Premièrement, défendre un relativisme spirituel dans le sens noble, c’est-à-dire affirmer que Dieu seul est absolu et que toutes les religions lui sont relatives.
Deuxièmement, demeurer fier d’être chrétien, c’està- dire, disciple de Jésus qui est celui qui accompagne vers cette Réalité ultime que nous nommons Dieu.
Troisièmement, refuser de vouloir convertir au christianisme un musulman ou un bouddhiste, leur voie est aussi valable que la nôtre. Loin du syncrétisme, chaque religion en restant ancrée dans sa tradition et en gardant son génie propre, rend possible l’enrichissement mutuel.
Pour faire un don, suivez ce lien
 Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté
Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté