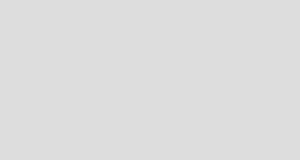L’Église évangélique luthérienne de France et l’Église réformée de France envisagent la création d’une Église protestante unie organisée en régions confessionnelles. Les synodes régionaux de l’automne 2008 sont invités à en débattre.
Le protestantisme, fondamentalement attaché à la liberté de conscience, porte en lui les germes de l’individualisme et de la division. Cette critique fréquente, il faut la recevoir tant il est vrai qu’on ne compte plus, depuis la Réforme, les courants exégétiques qui se sont disputés, les écoles théologiques qui se sont opposées et, au bout du compte, les Églises qui se sont séparées. Mais il faut aussi remarquer que le souci obstiné de l’unité et l’engagement sans faille pour la dynamique oecuménique, au sens le plus large, sont une constante de la culture protestante.
L’Église évangélique luthérienne de France (EELF) et l’Église réformée de France (ERF), sont les héritières des Églises du XVIe siècle fondées sur l’Évangile tel que les Réformateurs l’ont redécouvert et prêché. Elles partagent la même foi au Christ vivant, témoin de l’amour de Dieu pour tout être humain, et la même espérance pour le monde. Elles n’en ont pas moins vécu des oppositions et des divisions tout au long de leur histoire. Ces divergences et les contextes dans lesquels elles ont évolué ont généré une manière, propre à chaque tradition, de se référer à des textes fondateurs, d’exprimer ses convictions, d’organiser l’Église, de vivre le culte et la liturgie ou encore d’accompagner la piété personnelle des fidèles. Mais, au-delà de leurs particularités, qui ne sont ni accessoires ni secondaires, l’Église évangélique luthérienne et l’Église réformée de France ont reçu une vocation commune et une mission : la proclamation de la Parole de Dieu et l’annonce de la Bonne nouvelle au monde. Là se joue leur raison d’être. Et c’est au nom de la fidélité à cette vocation commune qu’elles ont déjà pris dans le passé, avec de nombreuses autres Églises protestantes, des initiatives multiples en vue d’un meilleur témoignage et d’un meilleur service de l’Évangile.
La démarche qu’elles engagent avec confiance à la demande des synodes, s’inscrit résolument dans cette perspective. Il ne s’agit pas de clore les débats théologiques et ecclésiologiques qui peuvent exister entre les deux unions d’Églises, ou en leur sein, ni d’uniformiser les pratiques ecclésiales existantes, et encore moins d’écrire une nouvelle confession de foi de référence, mais de proposer un modèle original d’unité qui prend ses racines dans les affirmations de la Concorde de Leuenberg et s’efforce de rendre visible la communion déclarée entre les Églises luthériennes et réformées. La Concorde de Leuenberg (1973) reconnaît en effet cette pleine communion.
Au début du XXe siècle, la Fédération protestante de France a mis en place un type d’unité fédératif dans lequel chaque Église membre confie la représentation publique et la coordination de services à une instance reconnue ; en 1938, différentes unions d’Églises réformées, réformées évangéliques, libres, méthodistes se sont regroupées pour restaurer l’unité de l’Église réformée de France sous une même Déclaration de foi. Il y a peu, en Alsace-Moselle, l’Église réformée et l’Église luthérienne ont créé une nouvelle union tout en se maintenant institutionnellement et lui ont transféré certains domaines d’autorité. Autant de modèles d’unité parmi d’autres encore en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, aux États-Unis… Le projet en débat dans les paroisses, les Églises locales et les synodes de l’EELF et de l’ERF, se veut une base commune de vie. Constitué d’une seule union nationale avec un seul synode national et un seul corps de ministres, le modèle d’Église protestante unie s’apparente à une sorte de consensus différencié où chacun reconnaît dans l’expression de foi de l’une et de l’autre tradition confessionnelle la vérité de l’Évangile. Il implique la prise en compte la plus large possible des dons et des richesses spirituelles de chaque Église, de leurs spécificités liturgiques, des règles qu’elles se sont données pour organiser la vie ecclésiale locale et régionale, mais aussi des convictions théologiques sur lesquelles elles se fondent. C’est au prix exigeant d’un accueil sans confusion de la diversité, d’une attention permanente à l’autre, notamment la minorité, d’un respect mutuel des craintes légitimes de voir disparaître son identité, que l’unité de la communion luthéroréformée sera visible et que son témoignage sera pertinent et incisif dans la société contemporaine.
Le projet qu’elles ont ouvert peut être une aventure enthousiasmante pour l’Église évangélique luthérienne et l’Église réformée de France et l’occasion d’un nouvel élan, tant au plan national qu’au plan local. Elle permet déjà, par les rencontres, les échanges et les dialogues que suscite le processus engagé, d’élargir l’espace de sa tente. L’Église protestante unie est une chance à saisir pour mieux relever les innombrables défis qui se posent aux chrétiens, aujourd’hui. Elle est également la possibilité d’offrir, en lien étroit avec l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine, une image renouvelée du protestantisme français dans l’espace public et de faire en sorte qu’il continue d’être une richesse de l’Église universelle.
• Le salut par la grâce seule est le fondement de tout protestantisme. Les luthériens rappellent que ce principe, seul incontournable, précède celui de l’Écriture seule. Il constitue d’ailleurs une grille de lecture de la Bible elle-même ; ce qui, en elle, n’enseigne ou n’enseignerait pas le Christ et ce sola gratia n’est pas véritablement évangélique. D’où le fait qu’il n’y a pas là de tentation fondamentaliste.
• Le luthéranisme a un sens fort de la tradition. Le port de la robe pastorale signifie cela : elle efface la personnalité du prédicateur et le désigne comme porteur d’une tradition. La confession de foi, par exemple, est davantage un texte toujours identique qu’un texte toujours nouveau. Le sens de l’Église et une méfiance vis-à-vis de l’individualisme sont là importants.
• Il a un sens fort de l’ordre et de l’autorité : ce n’est pas pour des questions de pouvoir ou de validité que le pasteur (et non pas un laïc) préside les sacrements, mais par respect d’un certain ordre : le pasteur a reçu cette mission ; il faut la respecter.
• Il insiste sur l’Église visible et attribue une grande importance aux signes visuels. D’où la place accordée aux sacrements (pratique aussi du signe de croix, d’un crucifix). La cène peut ainsi être célébrée chaque dimanche. La présence réelle du Christ dans les sacrements n’y est pas purement spirituelle ou symbolique. La cène s’inscrit dans une réalité duelle où elle et la prédication proclament ensemble (sans véritable hiérarchie) le même Évangile, l’une sous forme visible, l’autre sous forme audible. Le culte est une ellipse avec ces deux foyers.
• La lecture de la Loi n’est pas indispensable. Une exhortation à la fin du culte lui donne sa bonne place, nécessaire et suffisante. Cette lecture est toujours menacée par un moralisme et un légalisme contraires au sola gratia.
Laurent Gagnebin
Pour faire un don, suivez ce lien
 Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté
Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté