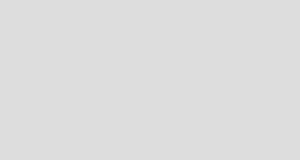Dans notre belle Alsace, au fond, quelque chose ne tourne pas rond. Au fond de nos verres à vin, s’entend. Les raisins sont plus sucrés. Les vins plus alcoolisés. Passe encore. On grommelle un coup. Mais il y a plus grave. On ne rigole plus. Et s’il nous fallait finalement changer nos cépages et passer… à du vin rouge ?
Dans notre belle Alsace, au fond, quelque chose ne tourne pas rond. Au fond de nos verres à vin, s’entend. Les raisins sont plus sucrés. Les vins plus alcoolisés. Passe encore. On grommelle un coup. Mais il y a plus grave. On ne rigole plus. Et s’il nous fallait finalement changer nos cépages et passer… à du vin rouge ?
Il fut un temps, l’idée eut inspiré des commentaires moqueurs. Plus maintenant. Avec la hausse des températures, nos vignes changent et il nous faudra peut-être, à terme, changer nos vignes. Ce n’est toutefois qu’un effet parmi d’autres, bien plus sérieux, des changements climatiques. Deux ans après la COP21 tenue en France, où en sommes-nous ?
Nous ferons le point sur les données scientifiques récentes, en situant notamment la question au sein du défi écologique large. Nous nous demanderons en quoi cela regarde l’éthique chrétienne. Nous envisagerons, façon kaléidoscope, ce que signifie une conversion écologique qui, si elle vient à la fin, n’en est qu’à ses débuts.
Le constat scientifique
Le défi écologique large
Un demi-siècle après le premier Sommet de la Terre, qui se tint à Stockholm en 1972, avons-nous progressé sur le front écologique ? L’empreinte écologique est un indicateur synthétique reconnu qui permet un regard d’ensemble. Il rassemble sous une même unité de surface, l’hectare global (hag), toutes les consommations de ressources et les émissions de déchets d’un individu ou d’un groupe. À l’échelle planétaire, il permet d’évaluer si l’impact écologique de l’humanité dépasse la capacité bioproductive de la Terre.
La comparaison entre empreinte écologique et biocapacité montre que depuis 1970, chaque année, nous avons prélevé et émis dans la nature plus que ce qu’elle nous fournissait et pouvait absorber. Aujourd’hui, notre empreinte est de 2,9 hag par personne, quand la biocapacité de la planète est de 1,7 hag. Même un théologien peut faire le calcul : nous utilisons l’équivalent de 1,7 planète par an. D’un mot : nous sommes en situation non-soutenable de dépassement global.
L’empreinte d’un pays dépend de sa richesse économique. En moyenne, un pays à bas revenu « pèse » 0,6 planète ; un pays à revenu moyen-bas 0,7 planète ; un pays à revenu moyen-haut 2,0 et un pays à haut revenu 3,7 ! Non seulement les inégalités sont prégnantes, mais encore, ces chiffres dévoilent que le récit de la généralisation du mode de vie occidental à l’ensemble de l’humanité, soit le projet « développementiste » lui-même, est mensonger. Les projections sont alarmantes. Selon le scénario d’une poursuite modérée (!) des trajectoires actuelles, la dynamique en jeu nous mènerait à une empreinte écologique globale d’environ 3 planètes d’ici à 2050.
De façon plus détaillée, l’examen du système Terre comme un équilibre délicat a mené des scientifiques à identifier neuf frontières planétaires qu’il ne nous faut pas franchir, au risque de mener le système vers un état neuf et dangereux : la perte de biodiversité, les changements climatiques, la pollution, la déplétion de l’ozone stratosphérique, la concentration en aérosols atmosphériques, l’acidification des océans, le changement des flux biogéochimiques – et d’abord ceux du phosphore et de l’azote –, l’usage des terres et l’usage de l’eau douce.
La perte de biodiversité tout comme les changements climatiques sont des frontières particulières, en ceci que leur dépassement, chacun en lui-même, peut mener le système Terre dans un nouvel état. Parmi les sept frontières que la science sait aujourd’hui quantifier, quatre ont été dépassées, nous menant hors de l’espace d’opération sûr pour l’humanité. Le changement d’usage des sols et les changements climatiques sont entrés dans la zone de risque croissant. La perte de biodiversité et les perturbations des cycles du phosphate et de l’azote sont entrés dans la zone de danger élevé. Il faut prendre note de ce que les deux frontières identifiées comme systémiques ont été franchies.
Après la COP21, où l’attention médiatique et sociétale s’est focalisée sur la question des changements climatiques, il importe de rappeler, d’une part, qu’au moins huit autres enjeux se posent à nous dans le cadre global d’un dépassement des limites avancé, et d’autre part, que la perte de biodiversité pose une menace systémique aussi grave que les évolutions du climat. Sait-on qu’il y a des COP de la biodiversité ?
Ce tableau dépeint une situation inédite dont la signification a seulement commencé d’être examinée : adieu l’Holocène, nous serions passés dans une nouvelle ère géologique, l’Anthropocène, l’être humain étant devenu une force tellurique et le principal déterminant des évolutions du système Terre.
Les changements climatiques
La source qui fait autorité quant à l’état des connaissances scientifiques sur les changements climatiques est le Rapport d’évaluation publié tous les cinq à six ans par le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC).
Il s’agit bien d’un « état des connaissances » : le GIEC n’effectue pas de recherche lui-même ; il lit l’ensemble de la littérature académique internationale et en publie une synthèse. Le degré de certitude est explicité : le GIEC, pour chacun de ses énoncés, fournit une évaluation en termes probabilistes.
Parmi la masse de données de sa partie scientifique, publiée en 2013, trois éléments-clé sont à retenir. Tout d’abord : les scientifiques sont aujourd’hui certains que l’atmosphère se réchauffe. Sa température a augmenté en moyenne de 0,85 °C depuis la période préindustrielle. Les trois dernières décennies ont chacune été des décennies records. Même les climatosceptiques, en général, ne le contestent plus ; ils se replient sur les causes de ce réchauffement, qui ne serait pas dû à l’humain.
Or, tel est bien le second enseignement du rapport : nous sommes à plus de 95 % sûrs que les activités humaines sont la principale cause de ces changements depuis la moitié du XXe siècle. Il fut un temps, la probabilité n’était que de 50 %. La recherche a accru le degré de confiance. Aucun des processus qui ont changé le climat par le passé n’est à l’œuvre actuellement. Ce sont les émissions des divers gaz à effet de serre (GES) dues aux activités humaines qui permettent de rendre compte de l’évolution constatée. Les niveaux de GES atteints sont inédits depuis au moins 800 000 ans.
Pour rappel, les GES exacerbent un phénomène qui, de lui-même, est bénéfique à la vie. Ces gaz capturent dans l’atmosphère le rayonnement infrarouge de la Terre, permettant qu’il fasse en moyenne +15 °C et non -18 °C à la surface de notre planète. On peut imaginer une douce couverture posée sur notre belle sphère bleue. Par-dessus, ces dernières décennies, nous avons ajouté des couches. Au risque de la surchauffe.
Le troisième grand enseignement tient aux futurs : s’il est toujours possible, d’un point de vue mathématique, de rester sous les 2 °C – et même 1,5 °C –, le risque existe également, selon le scénario poétiquement nommé RCP8,5, d’aller jusqu’à 4,8 °C d’ici la fin du siècle. Tout réchauffement supérieur à 2 °C nous expose à un possible « emballement » climatique, dont les conséquences seraient dramatiques, localement potentiellement létales, pour les écosystèmes et les êtres humains en leur sein.
Depuis ce rapport, la publication de plusieurs études scientifiques laisse présager une situation plus inquiétante encore. Par exemple, on sait que la hausse du niveau de la mer s’accélère : elle est 25 à 30 % plus rapide depuis 2004 qu’entre 1993 et 2004 ; la température des océans, elle aussi, progresse en fait 13 % plus rapidement que ce que l’on pensait, et là aussi le phénomène s’accélère : il est deux fois plus élevé depuis 1992 que depuis 1960 ; enfin – et pour nous en tenir là –, une attention accrue est portée au méthane, un GES au « pouvoir de réchauffement global » 28 fois supérieur en CO2, dont il a été montré que la hausse de concentration dans l’atmosphère s’est accélérée depuis 2007 et a été incroyablement élevée en 2014 et 2015 : 20 fois plus qu’au début des années 2000.
Éthique chrétienne et changements climatiques
Éléments d’éthique chrétienne
Quatre lieux éthiques décisifs seront concernés par ces changements.
En théologie de la création, selon une lecture de l’« image » de Dieu appuyée sur l’hébreu tsélèm (Gn 1,26) qui signifie « statue », l’être humain tient lieu de Dieu dans la création. Sa représentation doit être fidélité à un Dieu relation, qui a librement créé par amour, se soucie de ses créatures, dont le dessein est celui d’une vie féconde, pléthorique, diversifiée et pacifique. Nous pouvons y lire le commandement suivant : « Sois un bon lieu-tenant du Dieu Créateur au sein de la belle bonne création dont tu fais partie ».
Après le déluge, Dieu fait alliance avec Noé, ses fils et tout être vivant de la terre, pour toutes les générations à venir (Gn 9,11-17). Il s’engage à ne plus jamais exterminer de chair par les eaux du déluge, à ce que la terre ne soit plus jamais ravagée. Cette alliance est perpétuelle, unilatérale et inconditionnelle. S’il est admis que le discernement éthique de l’humain s’appuie sur la volonté de Dieu, l’alliance postdiluvienne mène à définir une vocation noachique : « Sauvegarde et promeus la biodiversité ».
Selon Jésus-Christ, le commandement qui abrège la loi et les prophètes est le double commandement d’amour-agapè (Mc 12,28-34 et //). La parabole du bon samaritain expose une vision dynamique du prochain, qui n’est pas l’aidé mais l’aidant ; aimer son prochain signifie se faire le prochain d’autrui. D’où nous formulons le second commandement ainsi : « En disciple et témoin de Jésus-Christ, par amour-agapè, sois le prochain d’autrui de façon inconditionnelle ».
Le cœur de la prédication de Jésus-Christ fut l’arrivée du Royaume et la nécessité de la conversion (Mc 1,14-15 et //). Si le second commandement d’amour agapè peut laisser accroire que l’amour est affaire purement interindividuelle, la prédication du Royaume de justice et de paix souligne qu’il doit être compris comme intégrant une dimension sociale. Ainsi : « En disciple et témoin de Jésus-Christ, lutte pour la justice et la paix, dont l’achèvement est espéré dans le Royaume ».
Les conséquences des changements climatiques
Voyons comment les changements climatiques mettent ces lieux en jeu.
Les biens et services écosystémiques seront mis en danger, de façon plus ou moins grave en fonction de la trajectoire d’émissions de GES que nous suivrons. La qualité de l’air se dégradera (la concentration en ozone et autres polluants s’accroît avec la température) et le couple température-humidité élevé menace de rendre de vastes territoires inhabitables une partie de l’année. L’eau douce salubre sera plus rare en de nombreux lieux (ce sera un or bleu). Les rendements agricoles (en particulier de blé, riz, maïs et soja) seront en baisse dans les régions tropicales et tempérées. Des événements météorologiques extrêmes (sécheresses, inondations, vagues de chaleur…) seront plus fréquents et plus intenses. La montée du niveau de la mer ira en s’accélérant (atteignant jusqu’à +82 cm en 2100), tout comme l’acidification de l’eau des océans (dont le pH a déjà baissé de 0,1). La chute de la biodiversité animale et végétale s’aggravera (1 espèce sur 6 est directement menacée par le facteur climatique). Les parasites porteurs de maladies comme le paludisme étendront leurs territoires dans le monde.
Ceci affectera tous les pays, de manière différenciée en nature comme en intensité, en fonction du réchauffement effectif et de l’adaptation mise en place (ou non). Des régions et des pays risquent de disparaître sous les eaux (il nous faudra redessiner la carte du monde). Les moyens de subsistance seront affectés à la fois par les impacts ponctuels (comme la survenue d’un typhon) et par les changements de long terme (comme la baisse de la pluviométrie ou l’absence de poissons à pêcher). Dans de nombreuses régions, la santé des populations se dégradera (par exemple, le manque d’eau douce salubre compromet l’hygiène et augmente le risque de maladies diarrhéiques). Les coûts économiques seront élevés à très élevés (de 700 milliards d’USD en 2010, ils pourraient atteindre 3,6 % du PIB mondial dès 2030). Le coût humain sera important (de 400 000 morts par an en 2010, il pourrait atteindre 700 000 dès 2030). Jusqu’à 250 millions de personnes pourraient migrer d’ici 2050 (qu’on songe que la moitié de l’humanité vit à moins de 60 km de la mer). En dernier lieu, ce sont la sécurité sociale, internationale et la paix qui sont en jeu.
Ces risques généraux ne s’actualiseront pas de la même manière selon le niveau de vulnérabilité et la capacité d’adaptation des individus, communautés, pays et écosystèmes. En particulier, les pauvres, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les handicapés et les peuples autochtones seront plus exposés que les autres. Il importe enfin de noter que si nous limitons l’horizon à l’année 2100, les changements induits dépasseront largement cette date : de nombreuses tendances dureront plusieurs siècles, voire millénaires.
Reprise éthique
Est-il besoin d’user d’emphase ? La moitié seulement de ce tableau de risques devrait suffire à placer les changements climatiques parmi les préoccupations majeures de l’éthique chrétienne, donc des croyants et des Églises. Reprenons pourtant l’enjeu au vu des quatre lieux éthiques identifiés.
Certains échouent à être les bons lieu-tenants du Dieu Créateur au sein de la belle-bonne création dont ils font partie. S’il fallait identifier Dieu à partir de leurs comportements conscients égoïstes à courte vue, il serait bien éloigné de celui auquel nous croyons.
Certains trahissent leur vocation noachique en étant sur le point de provoquer ce dont la promesse de Dieu garantissait la non-répétition : la disparition de plus des trois-quarts des espèces vivantes, processus d’ailleurs néfaste et mortifère pour celle qui en est la cause.
Certains faillissent à aimer leurs prochains et s’éloignent des autres, qu’ils soient proches ou lointains dans le temps comme dans l’espace ; ils polluent le futur même de ceux qui sont le plus proches de leurs cœurs, leurs enfants et leurs petits-enfants.
Certains faillissent à être ferments de justice et de paix, car non seulement la paix est mise en danger, mais aussi, les populations les plus vulnérables, notamment les pauvres, ont une responsabilité souvent limitée, sinon quasi-nulle, dans les émissions de GES.
L’usage du pronom « certains » provient de ce que l’on ne saurait voir l’humanité, dans son ensemble, comme un agent. Serait-il juste de considérer comme équivalentes, dans un identique collectif, la contribution et la responsabilité du Français moyen et celles de l’Éthiopien moyen ? Ou à l’échelon national, de l’Indien fortuné et du villageois d’Orissa au mode de vie traditionnel ? Ajoutez les enjeux de l’éducation, donc de la conscience des conséquences des actes, de l’intentionnalité et de la liberté (ou non) d’agir autrement au quotidien, soit les conditions structurelles, et le nom « humanité » est vide de sens.
Il est cependant des personnes qui savent, qui ont une marge de manœuvre, dont l’empreinte carbone est insoutenable et qui poursuivent leurs modes de vie ou n’ont effectué des changements qu’à la marge et s’en satisfont. À leur endroit, les changements climatiques lancent un appel à la conversion.
La conversion écologique
Comment réorienter nos vies et nos sociétés vers un chemin soutenable et juste ? Comment faire droit à la fois aux limites écosystémiques et à la quête du bien-être social ? Il y aurait tant de choses à aborder : la transition énergétique, l’économie circulaire, le « zéro déchet », etc. Nous mettrons en avant trois éléments.
Les changements de regards
Le premier pas n’est pas technique. Il est spirituel. Il n’y aura pas d’évolutions des structures et des modes de vie extérieurs sans une conversion intérieure. Dans le Nouveau Testament, la conversion se dit metanoia, ce qui signifie littéralement « changement de regard ». Ce changement devrait avoir lieu en deux endroits.
D’une part, il devrait se produire dans nos esprits. La conversion signifie adopter une nouvelle représentation de nos économies, intégrées dans les écosystèmes, prenant en compte la notion de limites – comme le disait récemment Nicolas Hulot, il s’agit de passer d’une économie de cowboys à une économie de cosmonautes : notre planète est un vaisseau spatial et non un eldorado. Elle signifie de surcroît l’adoption d’une écologie intégrale, soit la compréhension que les enjeux sociaux et écologiques vont de pair, que travailler à l’un c’est travailler à l’autre. Où la France eut-elle à déplorer le plus grand nombre de décès lors de la canicule de 2003 ? En Seine-Saint-Denis.
D’autre part, le changement devrait se produire en nos cœurs. La conversion signifie d’abord voir la Terre comme un don bon, pour lequel nous sommes reconnaissants. Nulle idéalisation romantique de la nature, qui a ses duretés. Mais conscience de ce qu’elle nous porte et nous apporte. D’où un amour pour la création et une volonté de prendre soin et de transmettre. Ensuite, il s’agit de changer notre monde de valeurs. Tandis qu’une économie obsolète valorise la cupidité, que Paul appelle une idolâtrie (Éph 5,5), valorisons la satisfaction et la simplicité (1 Tim 6,6-8). Tandis qu’elle est dynamisée par la séduction des richesses, qui selon la parabole du semeur étouffe la Parole de telle sorte qu’elle ne produit rien, soyons dynamisés par l’amour et le souci du prochain (Lc 10,25-28). Tandis qu’elle fait trop souvent de l’argent une fin en soi, affirmons que nous ne pouvons servir deux maîtres, Dieu et Mammon (Mt 6.24).
Cette conversion sera réalisée dans notre vie spirituelle chrétienne, nourrie par la lecture des Écritures et la théologie, enracinée dans la prière, vitalisée par les sacrements, vécue en communauté, vitaminée par les collaborations au sein de l’Église universelle. C’est Dieu lui-même, c’est l’Esprit Saint, qui nous permet de ne pas désespérer et laisser tomber, mais de nous engager et d’y croire. Paul nous dit : « Ce n’est pas toi qui portes la racine, mais la racine qui te porte » (Rm 11,18).
Les transitions concrètes
Le pas suivant est celui des évolutions pratiques. Le chantier est immense. Chaque domaine de l’existence est concerné : l’habitat, les transports, la nourriture, les vêtements, les loisirs et ainsi de suite. Il existe sur papier et en ligne de remarquables ressources ; on pourra notamment consulter le site de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Nous sommes nombreux à avoir commencé à être le changement que nous voulons pour le monde. Mais pour la plupart, nous pouvons faire mieux et plus.
Proposons, au niveau personnel, un changement à l’impact immédiat, conséquent, et qui ne dépend que de soi : la réduction de la consommation de viande, en particulier de viande rouge, et l’achat de viande de qualité. L’industrie de la viande émet plus de GES que tous les transports du monde. 1 kg de bœuf émet 18 kg équivalents CO2 tandis que 1 kg de carottes en émet 0,4 kg (oui, 45 fois moins). On ne posera pas ici la question existentielle de l’opportunité du bœuf-carottes. Soulignons que les co-bénéfices d’une réduction de cette consommation au profit des légumes, dans l’idéal locaux, de saison et bio, sont nombreux, de la santé à d’autres enjeux écologiques (1 kg de bœuf, ce sont 15 000 L d’eau, soit 187 douches). En plus, de nombreux chefs et publications mettent à l’honneur les légumes dans des plats gourmands et savoureux. Alors, (pois) chiche ?
Au niveau collectif, un bel outil œcuménique est disponible pour les paroisses depuis septembre : le « Label Église verte ». Porté par les institutions chrétiennes chrétiennes en France, dont la Fédération protestante de France, ainsi que des ONG comme le CCFD-Terre solidaire, ce label est un outil destiné à encourager et à faciliter la conversion écologique d’une paroisse, que celle-ci parte de zéro ou soit déjà engagée. Le site internet guide vers un éco-diagnostic qui couvre tous les aspects de la vie paroissiale, de la gestion du bâti à la vie spirituelle. Il fournit à la fois l’occasion d’un bilan et un programme. L’ayant rempli et s’étant engagée à progresser, la paroisse obtient le label, au niveau de progression qui est le sien. Sont aussi proposées des ressources sous forme de fiches pratiques, qui aident par exemple à préparer un culte sur la création ou à mettre en place un tri des déchets lors d’un événement paroissial. Enfin, un réseau national et œcuménique des paroisses labellisées et intéressées est animé et se retrouve à l’occasion d’une journée annuelle. Alors, chiche ?
L’engagement politique
Il y a une limite structurelle à ce qu’une personne ou une communauté peut faire. Par conséquent, il nous faut changer les lois pour une prise en compte résolue et cohérente du défi écologique et du temps long. Les contributions nationales sur la table post-COP21 nous mènent à plus de 3 °C de réchauffement à la fin du siècle. Les États feront un point d’étape à la COP24, en 2018. Ils savent déjà qu’ils sont loin du compte. Nous devons aller plus loin, plus vite, plus fort.
Cela débute par la bataille culturelle, car c’est une nouvelle vision du monde et un nouveau monde de valeurs qu’il faut propager, contre le réductionnisme économiciste, croissanciste, eudémoniste (dont l’objectif est le bonheur), individualiste et anthropocentriste du passé. Cela se prolonge dans l’engagement institutionnel. Au niveau personnel, le vote compte, bien sûr, mais pourquoi ne pas se porter candidat ? Pensons surtout aux échelons territoriaux et communal, où de réelles avancées transpartisanes sont possibles. Donald Trump a décidé le futur retrait des États-Unis de l’Accord de Paris ? 40 grandes villes américaines ont annoncé viser 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050 et 34 États du pays ont des plans climat. Au niveau ecclésial, faisons du plaidoyer auprès des décideurs, à tous les niveaux, chaque fois qu’un moment politique clé se profile.
Dans plusieurs parties du monde, nous voyons que face aux noirceurs de notre temps, des électeurs soutiennent de façon croissante des politiciens qui prétendent défendre leur nation d’abord, au lieu de reconnaître notre communauté de destin ; qui désignent des boucs-émissaires, au lieu de discerner les responsabilités ; qui entendent élever des murs, au lieu de construire des ponts. Il est légitime de craindre que le déploiement de la crise écologique rendra cette posture dangereuse plus forte. C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de chrétiens qui entrent en politique et accompagnent les gens, prennent en charge leurs peurs et construisent avec eux la réalité de demain, en optant résolument pour l’ouverture, l’espérance et la confiance.
Comment conclure ? Ce n’est que le début !
Il est juste de comprendre l’enjeu écologique comme une menace vitale. C’est ce que nous dit la science. Il est juste de voir les changements climatiques comme posant un défi éthique inédit. Par lui, c’est non seulement le soin de la partie de création qui nous accueille, mais aussi les grands lieux traditionnels de l’agir chrétien qui sont impactés : il n’y aura pas de luttes efficaces contre la pauvreté, contre les migrations involontaires, pour la justice, en faveur de la paix, en défense des droits humains, sans travail acharné sur le climat.
Ce qui signifie que c’est aussi une formidable opportunité. C’est l’opportunité de redessiner nos façons de voir le monde, de repenser notre économie, de reformuler notre but commun. C’est l’opportunité de rendre nos sociétés réellement prospères, en répondant aux besoins de tous suivant les moyens de la planète. En définitive, libérés par la grâce de Dieu, c’est l’opportunité d’être en communion avec le Dieu de la vie. Il n’y a peut-être pas de tâche plus difficile. Mais il n’y a pas de plus beau défi.
À lire l’article de Pierre-Olivier Léchot » Le défi écologique «
Pour faire un don, suivez ce lien
 Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté
Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté