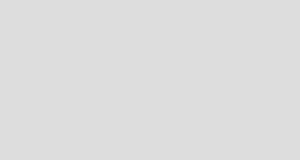La possible ouverture de l’AMP pour les couples de femmes ou les femmes seules a rouvert la discussion autour du droit à l’enfant. Je constate que cette expression « droit à l’enfant » est principalement dans la bouche et sous la plume de ceux qui refusent qu’une telle possibilité soit même envisagée et qui lui substituent immédiatement le « droit de l’enfant ». Plus qu’un droit à l’enfant, il me semble que la demande est d’abord celle de l’égalité d’accès à la technique médicale. Mais intéressons-nous plutôt à ce droit de l’enfant qui est opposé. Ce droit de l’enfant est celui d’avoir un père et une mère, disent ceux qui sont hostiles à ce qu’une femme vivant avec une autre femme puisse mettre au monde un enfant. Qu’est-ce qui légitime ce droit sinon la biologie qui indique qu’il faut du masculin et du féminin pour obtenir un embryon ? Mais nous savons tous que si un géniteur et une génitrice sont nécessaires pour naître, ils sont insuffisants pour qu’un enfant vienne au monde, c’est-à-dire qu’il devienne humain. Nous savons tous que l’essentiel de l’éducation qui fera d’un bébé un adulte libre et donc responsable est prodigué par de multiples personnes et certainement pas par les seuls géniteurs.
Élargir la communauté éducative
Passons sur les cas, assez nombreux, d’enfants dont le père biologique n’est pas celui qui a reconnu l’enfant à la naissance. Ce à quoi un enfant a droit, c’est une communauté éducative, une multitude de vis-à-vis, aussi différents les uns des autres et pas uniquement en fonction du premier chiffre de leur numéro de sécurité sociale. Pourquoi se restreindre et focaliser le droit de l’enfant à un père et une mère alors que les grands-parents pourraient tout autant être un droit qui donnerait accès à ce que la génération précédente peut offrir : une mémoire spécifique, un rythme de vie différent, une fragilité que les parents s’efforcent souvent de masquer, une forme de grâce dans les relations qui sont débarrassées des fortes projections par lesquelles l’enfant devrait réussir ce que les parents n’ont pas réussi eux-mêmes. La multiplicité de vis-à-vis pour l’enfant rappelle qu’on ne fait pas un enfant pour soi, que l’on soit hétérosexuel ou non. Le droit de l’enfant est d’avoir autour de lui des adultes aimants, c’est-à-dire des personnes qui n’ont plus de problèmes majeurs à régler sur le dos des autres et qui sont suffisamment disponibles pour prendre soin de l’enfant puis de l’adolescent en respectant ses besoins du moment, en respectant ses élans et ses hésitations, en lui prodiguant l’affection qui sera nécessaire pour qu’il développe une réelle confiance en soi. C’est aussi bien le rôle des enseignants, que des chefs scouts, des parrain et marraine le cas échéant, du pasteur, des catéchètes, d’un professeur de sport, de toute personne qui se trouve dans son environnement. Un enfant a surtout droit à de la bienveillance et à la vérité car, bien évidemment, il ne s’agirait pas de lui cacher son histoire personnelle. Quand nous regardons en direction des messies de la Bible qui constituent des figures de référence en matière d’humanité, nous constatons que le premier messie, Saül, trouvera en Dieu un père plus authentique que Qish. David, pour sa part, est manifestement l’enfant d’une relation adultère, selon le psaume 51 – c’est une raison qu’il donne au fait qu’il ait eu des relations sexuelles avec Bethsabée qui était mariée à un autre que lui. Quant à Jésus, on ne peut pas dire que sa cellule familiale constitue le modèle qui prévaut aux yeux des opposants à l’AMP élargie. Les textes bibliques subvertissent ce modèle contemporain par le fait que le fils premier-né était considéré comme appartenant à Dieu, et non à ses parents, qu’ils soient biologiques ou adoptifs. La parentalité est bien plus partagée dans les textes bibliques que dans le code civil français. Voilà une manière de dire que nos enfants ne nous appartiennent pas et, réciproquement, que les enfants ne sont pas en droit d’exiger tel ou tel adulte. Dans la perspective biblique, nos droits ne sont pas derrière nous, mais en avant. La grâce dit qu’un avenir est possible pour chacun de nous, elle ne dit pas quelle doit être notre origine parce que l’origine, notre naissance, n’est pas significative de celui ou celle que nous sommes appelés à être. Dieu attire à la vie sans déployer un processus de reproduction.
À lire les articles de: Marianne Carbonnier-Burkard « Le Comité d’éthique et l’assistance médicale à la procréation »
Frédéric Rognon « Assistance médicale à la procréation : enjeux, promesses et dérives »
Abigaïl Bassac et Constance Luzzati « Quelques questions éthiques liées à l’assistance médicale à la procréation »
Maxime Michelet « Le désir dissident »
Baptiste et François Thollon-Choquet « Une famille à raconter »
Pour faire un don, suivez ce lien
 Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté
Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté