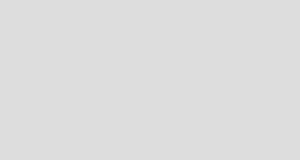De bons présages (Good Omens en anglais) est un roman écrit à quatre mains, paru en 1990. D’un côté Terry Pratchett, auteur d’heroic fantasy trempée dans l’humour britannique (Les Annales du Disque-monde), de l’autre le scénariste américain Neil Gaiman, auteur (entre autres) du roman American Gods, récemment porté à l’écran par les studios Amazon. Chez les deux auteurs, une tangente étant visible : un intérêt marqué pour les mythologies et la réappropriation personnelle de leurs enjeux cosmogoniques. Après plusieurs tentatives avortées, la BBC s’associant avec Amazon Prime confie la réalisation d’une série télévisée à Neil Gaiman, Terry Pratchett étant décédé en 2015.
De bons présages (Good Omens en anglais) est un roman écrit à quatre mains, paru en 1990. D’un côté Terry Pratchett, auteur d’heroic fantasy trempée dans l’humour britannique (Les Annales du Disque-monde), de l’autre le scénariste américain Neil Gaiman, auteur (entre autres) du roman American Gods, récemment porté à l’écran par les studios Amazon. Chez les deux auteurs, une tangente étant visible : un intérêt marqué pour les mythologies et la réappropriation personnelle de leurs enjeux cosmogoniques. Après plusieurs tentatives avortées, la BBC s’associant avec Amazon Prime confie la réalisation d’une série télévisée à Neil Gaiman, Terry Pratchett étant décédé en 2015.
L’histoire qui nous est racontée
C’est d’abord celle de l’ange Aziraphale et du démon Rampa (Crowley en version anglaise). Le premier tenait l’épée de feu à la sortie du Jardin d’Éden, le second n’est autre que le serpent tentateur (d’où son nom). Malgré le fait que chacun travaille pour une « entreprise » concurrente, ces deux-là ont développé une amitié non-usuelle au cours des 6 000 ans qui nous séparent de la Genèse (ah oui, humour british oblige, les fossiles constituent une grande blague métaphysique que les paléontologues n’ont pas encore saisie !).
En Angleterre de nos jours, tout se passe pour le mieux pour nos deux comparses jusqu’au moment où leurs hiérarchies respectives décident du déclenchement du processus menant à l’Apocalypse. Cette imminence de la fin des temps les décide à agir afin d’éviter la destruction d’un monde qu’ils apprécient tant, ceci en influant notamment sur l’éducation du jeune Antéchrist. Nous ne dévoilerons pas d’avantage l’intrigue de cette série télévisée, pour ne pas courir le risque de tout « divulgâcher ». Ce qui nous intéressera ici, c’est l’approche du corpus biblique qui est pratiquée. Parce que c’est précisément dans ce corpus que la série trouve son matériau fictionnel.
Une lecture de la Bible
Il semblerait que nous soyons en présence d’une vue dualiste. Ce n’est pas étonnant : les auteurs de littérature de genre entrent souvent dans le corpus biblique par la porte gnostique (voilà qui en soi mériterait un article). On ne saurait les blâmer : l’aspect d’une réalité cachée propre à être appréhendée seulement par une caste d’initiés constitue une matière fictionnelle de première qualité. De plus, la foi chrétienne non-gnostique est en soi bien trop scandaleusement démocratique…
Ainsi le Ciel et l’Enfer se préparent à la guerre apocalyptique, en vertu du fait que l’histoire humaine est limpidement préprogrammée. Toute objection formulée à l’encontre de ce plan par l’un des deux protagonistes précités se heurte à un indiscutable « C’est ce qui est prévu de toute éternité ». Nous sommes donc en présence d’une eschatologie surdéterminée. À l’heure d’un revivalisme de l’intégrisme religieux de tous bords, ce parti pris scénaristique ne manque pas de nous interroger sur notre propre orgueil humain quant à notre volonté d’une compréhension globalisante, finaliste du destin de l’être humain tel qu’il est exposé dans les Écritures. Il nous place également face à notre rapport à elles : si celles-ci sont d’inspiration divine, quelle est la part humaine dans leur rédaction ? En ce sens, Good Omens est une invitation espiègle à la pratique herméneutique.
L’épisode de la croix
La séquence la plus intéressante de cette première saison se situe au début de l’épisode 3, lors d’un récapitulatif de la longue amitié de l’ange et du démon. Ceux-ci se rencontrent à l’occasion de divers événements bibliques et historiques. Ce faisant il se retrouvent au Golgotha. Alors que Jésus de Nazareth est crucifié, les deux personnages discutent des raisons qui l’ont amené à cette mort infamante, visiblement peinés à cause de leur foncière sympathie pour ce charpentier galiléen. Le démon s’enquiert alors de ce que prêchait ce Jésus. L’ange lui répondant « Aimez-vous les uns les autres », il s’exclame : « Ah ouais, ça énerve ! ».
Soudainement nous changeons complètement de registre. Alors que cette série télévisée était, jusque là, un moyen de nous avertir (métaphoriquement) sur les risques d’une tentation d’une lecture intégriste des Écritures, elle touche l’espace d’un court instant le cœur de la foi. Le scandale de la Croix relève le manque d’amour du genre humain. Évidemment parce que c’est insoutenable, ça énerve ! Et pourtant la foi chrétienne, ce n’est rien d’autre.
Ainsi, bien que le parti pris scénaristique du dualisme puisse refléter la perception qu’ont nos contemporains de ce que serait le christianisme, Good Omens a l’intuition qu’il y a autre chose derrière cet attirail eschatologique trop humain. Cette intuition n’est pas poursuivie, peut-être parce que, comme je l’indiquais plus haut, le dualisme permet une intrigue telle que voulue par les impératifs télévisuels. Mais peut-être aussi parce que ce scandale est jugé trop intense pour être appréhendé dans un tel cadre. À quand une équipe de théologiens pour traiter de ce scandale sur un mode fictionnel ?
Pour faire un don, suivez ce lien
 Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté
Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté