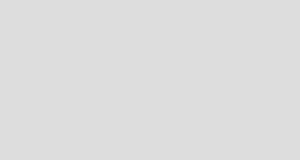Philippe Paroz, qu’est-ce qui vous pousse aujourd’hui, à l’âge de la retraite, à redonner à l’institut privé suisse Berna Biotech Pharma GmbH, spécialisé dans la fabrication de vaccins, une renaissance planifiée sur cinq ans, après sa disparition en 2006 ?
Philippe Paroz, qu’est-ce qui vous pousse aujourd’hui, à l’âge de la retraite, à redonner à l’institut privé suisse Berna Biotech Pharma GmbH, spécialisé dans la fabrication de vaccins, une renaissance planifiée sur cinq ans, après sa disparition en 2006 ?
J’ai travaillé quarante ans dans le domaine des vaccins, à l’institut Sérothérapique et Vaccinal Suisse, numéro cinq des fabricants de vaccins dans le monde. Notre institut a développé plus de cent produits dont 20 vaccins contre une trentaine de maladies transmissibles. L’institut, fondé en 1886, a été racheté en 2006 par une entreprise néerlandaise puis successivement par 3 sociétés américaines, plus intéressées à générer des milliards qu’à couvrir le marché assez compliqué des vaccins. Aujourd’hui on ne produit plus qu’un seul vaccin en Suisse.
Il nous semble dommage de perdre ce savoir-faire en Suisse et ainsi de dépendre de l’étranger. Nous possédons des souches vaccinales uniques de virus qui ne varient pas, comme celles de la rougeole, de la rubéole, des oreillons, de la varicelle et des hépatites A et B qui sont conservées dans l’azote liquide. Avec une petite équipe, nous avons décidé il y a trois ans de faire revivre cet institut. Les compétiteurs au niveau mondial étant très peu nombreux, le marché est régulièrement confronté à des ruptures de stock. De plus, plusieurs vaccins comme celui de la rougeole ne sont pas produits en quantité suffisante pour couvrir les besoins nécessaires à l’éradication de la maladie.
Vous êtes critique à propos des stratégies de vaccination choisies contre le Covid 19. Pourquoi ?
La pandémie de grippe de 1918 a commencé par un virus et elle s’est terminée deux ans plus tard avec la même souche. Avec la hâte des vaccinations contre le Corona, nous avons empêché la souche dominante de se multiplier, ce qui a permis à des mutants nécessitant de nouveaux vaccins de prendre la relève. L’histoire nous a appris qu’on ne combat pas une pandémie en vaccinant pendant la pandémie. Ou alors on limite la vaccination aux personnes à risque. Cette politique est issue du marketing très puissant de quelques entreprises, qui ont imposé l’idée que la seule voie pour contrer la pandémie était la vaccination.
Quelles autres voies préconisez-vous ?
En ligne générale, la lutte contre les maladies transmissibles se fait en 5 étapes, la vaccination n’étant que la dernière. Le développement d’un traitement qui permet de stabiliser puis de guérir la maladie devrait précéder la vaccination qui implique beaucoup plus de temps non seulement pour son développement mais surtout pour le contrôle de sa sécurité. Or cette fois, on a renversé cette approche en commençant par vacciner avec un produit issu d’une nouvelle technologie, certes connue en oncologie mais pas éprouvée ou contrôlée dans son application en vaccinologie. Dans la balance des risques et bénéfices nos autorités ont fait un choix, à mon avis, risqué mais pour l’instant le résultat leur donne raison. Nous ne savons toutefois pas si c’est le vaccin qui a vaincu la pandémie, ou son cycle biologique, car toutes les pandémies ont pris fin sans vaccination de masse jusqu’à ce jour.
Les milliards alloués au développement de ces vaccins auraient pu être partagés avec le développement de thérapies pour sauver des vies tout en poursuivant les efforts permettant à terme de prévenir de nouvelles vagues de cette maladie. Je pense que nous avons pris un certain risque en mettant sur le marché ces vaccins dont nous ne connaissons pas les effets secondaires à long terme. Par ailleurs, la vaccination obligatoire ne relève plus de la science : c’est une vision du monde et lorsque l’on croit savoir ce qui est bon pour les autres et qu’on l’impose, on risque la catastrophe. La vaccination, au lieu d’être appliquée à l’ensemble de la population,, aurait pu cibler les personnes à risque. Mon reproche majeur à nos autorités concerne les mesures d’incitation à la vaccination des femmes enceintes et des enfants. C’est une ligne rouge que je n’aurais pas franchie parce que nous ne disposions pas de données cliniques suffisantes au moment de cette décision. De plus, nous n’étions pas confrontés à une maladie pédiatrique grave pour les enfants.
Vous semblez dire que les vaccins ne sont pas la panacée. Quelle est votre conception globale de la santé ?
C’est une question difficile. Je voudrais tout d’abord rappeler que l’OMS définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Elle ne consiste pas seulement en une absence de maladie. Sous cet angle, il est clair que la spiritualité, qui influence notre style de vie, a un impact direct sur la santé. Notre état d’esprit joue un rôle-clé dans le développement de nos maladies. Ensuite, je suis convaincu que la santé des humains est en étroite corrélation avec celle des écosystèmes. Il y a toujours eu des pandémies, mais une des causes de leur croissance actuelle est l’impact de l’homme qui interfère avec la nature de façon démesurée, ce qui a pour effet de réveiller des germes qui sommeillaient ou vivaient au plus profond des entrailles de la terre. Si les virus accompagnent l’humanité depuis les origines, cette guerre d’espèces entre les micro-organismes et l’humanité instaure un certain équilibre, car éliminer l’espèce humaine serait une catastrophe pour les virus qui ne pourraient plus se répliquer, ce serait pour eux un acte suicidaire. L’ordre régnera donc mais sous quel régime de terreur ?
Pouvez-vous décrire quelques exemples de telles interférences ?
La guerre a toujours été un vecteur d’épidémies : déjà en 430 avant J.-C., la défaite de Périclès, lors du siège d’Athènes par Sparte, tient beaucoup plus aux micro-organismes qu’aux armes. Au XVe siècle, les Amérindiens, ayant vécu jusque-là dans le champ clos de l’Amérique, ne purent pas se défendre contre les virus de la variole et de la rougeole, contre les streptocoques et les pneumocoques importés du Vieux Monde. Ces micro-organismes furent infiniment plus meurtriers que les balles des conquistadors. En 1720 la peste réapparaît à Marseille, puis à Londres et à Calais. Ce sont à chaque fois des villes portuaires où l’on débarque des fourrures animales venues d’Asie et dont les Européens sont friands. Là-bas les chasseurs tuaient des marmottes malades, proies plus faciles mais dont les fourrures étaient porteuses de la bactérie de la peste. Aujourd’hui, en raison de la globalisation, des moyens de transport rapides et des migrations, un germe pathogène peut être diffusé beaucoup plus rapidement aux quatre coins du monde…
On sait aujourd’hui que le SIDA provient des chimpanzés dont les chasseurs ont mangé la viande contaminée. De nos jours, les déforestations en Argentine perturbent l’habitat d’un petit mammifère porteur du virus de Junin qui infecte les travailleurs de la forêt et déclenche une épidémie de fièvre hémorragique. L’élevage intensif oblige à nourrir les vaches par une alimentation artificielle. En y ajoutant des organes d’animaux malades abattus, on a infecté les vaches avec les prions qui ont déclenché la maladie de la vache folle. Par ailleurs, le réchauffement climatique favorise la diffusion du moustique tigre, porteur de virus comme ceux du chikungunya, de la dengue et du zika. Ainsi, l’ingérence de l’homme dans les écosystèmes peut déclencher de nouvelles pandémies.
Quel rôle peuvent jouer les vaccins contre ces fléaux ? Les anciennes maladies, qu’on croyait vaincues grâce aux campagnes de vaccination, se réveillent à nouveau à cause du relâchement des mesures sanitaires dans de nombreux pays. Il en va de même avec le refus de vacciner les enfants contre des maladies qui se font rares et qu’on considère comme bénignes, parce que des parents ignorent, ou sous-estiment, les complications dramatiques. Ainsi la diphtérie, la coqueluche et la rougeole se développent à un rythme qui ne peut nous laisser indifférents. La tuberculose devient un des plus grands défis de santé publique puisque la bactérie est devenue résistante à tous les antibiotiques connus.
Fondamentalement, les vaccins sont une part importante de la médecine moderne pour plusieurs raisons. Leur effet est préventif plus que curatif. Ils traitent les causes plutôt que les symptômes de la maladie. Ils ont de très faibles effets secondaires comparativement aux médicaments. Le coût des vaccins est très bas, comparé au traitement d’une maladie. Les vaccins sont une médecine naturelle, car ils ne soignent pas eux-mêmes mais activent le système immunitaire humain en lui fournissant des antigènes des germes pathogènes atténués ou inactivés, à partir desquels le système immunitaire peut fabriquer des anticorps qui lui permettront de se protéger contre les prochaines infections virales ou bactériennes. Enfin, les campagnes de vaccination constituent une approche de santé publique et représentent peut-être une des rares alternatives à la résistance croissante des germes pathogènes aux antibiotiques.
(propos recueillis par Gilles Bourquin)
Pour faire un don, suivez ce lien
 Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté
Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté