M.-N. & J.-L.D. : Quelle est pour vous l’importance du dialogue
inter-religieux ?
P.H. : Ce dialogue occupe une place importante dans mon rabbinat et
dans mes pensées. Le dialogue est la réponse à
la violence. Dans la Torah (Pentateuque) Caïn tue Abel, et nous
constatons que le dialogue est absent. Dialoguer implique l’écoute
de l’autre, donc la conscience de sa propre limite. Tel est le
sens de l’interdiction de consommer de l’Arbre : poser une
limite à sa propre manducation du monde, une limite à
sa propre vérité. 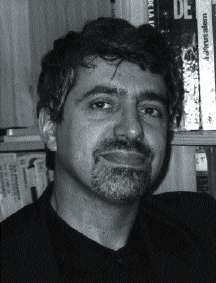 La
Loi pose toujours la dualité. Nos monothéismes offrent
la possibilité d’une revendication exclusiviste, parce que
nous avons à faire à un Dieu qui parle, qui s’incarne
ou qui conclut. La tentation est forte de dire c’est par moi que
ça passe. Selon moi, la vérité religieuse est absolue
pour celui qui y adhère, mais relative par rapport à la
foi d’autrui. Il ne s’agit pas d’interchangeabilité,
mais d’affirmer la valeur de la Paix au-dessus de la Vérité.
En Paix, on peut réfléchir sereinement à la Vérité,
alors que les conflits se font toujours au nom de la Vérité.
La
Loi pose toujours la dualité. Nos monothéismes offrent
la possibilité d’une revendication exclusiviste, parce que
nous avons à faire à un Dieu qui parle, qui s’incarne
ou qui conclut. La tentation est forte de dire c’est par moi que
ça passe. Selon moi, la vérité religieuse est absolue
pour celui qui y adhère, mais relative par rapport à la
foi d’autrui. Il ne s’agit pas d’interchangeabilité,
mais d’affirmer la valeur de la Paix au-dessus de la Vérité.
En Paix, on peut réfléchir sereinement à la Vérité,
alors que les conflits se font toujours au nom de la Vérité.
Pouvez-vous accepter une critique historique des textes bibliques
?
Cela ne pose aucun problème du point de vue de la foi juive,
car la Bible n’est d’aucune façon un livre d’Histoire
au sens universitaire. Dieu n’est pas venu révéler
la Relativité. Du point de vue de la foi juive, c’est-à-dire
pharisienne – ces maîtres judéens qui ont décidé
après la destruction du second Temple (+ 70) de canoniser les
textes –, la Bible nous apprend le service de Dieu. Non pas ce
que Dieu a à faire pour l’homme, mais ce que l’homme
a à faire vis-à-vis de Dieu pour assumer l’identité
pour laquelle il a été créé. Le scientifique
peut dire que la traversée de la mer Rouge (des joncs) est un
raz de marée, hypothèse plausible. Mais du point de vue
de la foi, je retiens le fait que la Torah ait voulu dire l’événement
de cette manière et non d’une autre, pour m’apprendre
à aimer Dieu et Le servir.
Que signifie pour vous « attendre un Messie aujourd’hui
» ?
|
Mon problème spirituel
est le problème matériel de mon prochain.
Rabi Israël Salanter.
xixe s.
|
La question du Messie est un vaste sujet qui mérite plus qu’une
courte réponse. Mais comme pour le judaïsme le Messie vient
à la fin, la question demeure secondaire par rapport à
mon action en tant -qu’homme, ici et maintenant. En fait, je n’attends
pas le Messie (c’est lui sans doute qui nous attend), j’agis
selon mes capacités pour faire de ce monde un sanctuaire de Dieu.
« Ils me feront un sanctuaire et Je résiderai au milieu
d’eux », dit l’Éternel (Ex 25,8). Ce monde messianique
serait celui dont parle Zacharie (14,9) : « Ce jour-là
Dieu sera un et son nom sera un », c’est-à-dire un
temps où l’humanité ne se fera plus la guerre au
nom de son Dieu, mais la paix au nom du Père (cf. Ml 2,10). L’inter-religieux
devient ainsi une manière de « rendre actif » le
Messie. Je sais que cela soulève des questions théologiques,
la foi, les œuvres, soit ! Mais cela doit-il remettre en cause
le verset « je place devant toi la vie et la mort, tu choisiras
la vie. » (Dt 30,19) L’Histoire est la résultante
de la somme des actions individuelles. La seule question qui me préoccupe
est : Comment puis-je être à l’origine d’une
bonne Histoire ?
Que faites-vous des athées ?
Ils m’apprennent à détruire nos idoles, grâce
à Dieu ! 
Philippe
Haddad
Propos recueillis par Marie-Noële et Jean-Luc Duchêne


![]()