A. Liberté de religion...
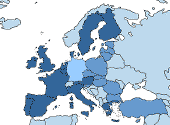 Le
17 décembre dernier, les 25 chefs d’Etat ou de gouvernements
européens se sont prononcés sur l’ouverture de
négociations pour l’adhésion de la Turquie à
l’Union européenne. Occasion d’énumérer
tous les préalables exigés dont le respect des droits
de l’homme, en première place. La liberté de religion
fait aussi question.
Le
17 décembre dernier, les 25 chefs d’Etat ou de gouvernements
européens se sont prononcés sur l’ouverture de
négociations pour l’adhésion de la Turquie à
l’Union européenne. Occasion d’énumérer
tous les préalables exigés dont le respect des droits
de l’homme, en première place. La liberté de religion
fait aussi question.
Par le Traité de Lausanne de 1923 et dans toutes
les constitutions ultérieures, la République turque
s’est engagée à traiter les minorités non
musulmanes comme tous ses citoyens sur un pied d’égalité,
indépendamment de leurs convictions religieuses. La Constitution
de 1937 est allée au-delà en introduisant le principe
de laïcité (séparation de l’Etat et des affaires
religieuses). Enfin, la Turquie, en tant que membre de l’ONU,
a ratifié la Déclaration universelle des droits de l’homme
de 1948.
Mais le contexte turc est complexe, les “ minorités
non musulmanes ” sont constituées d’une mosaïque
d’institutions religieuses ayant des statuts différents
face à l‘Etat turc ; l’application du principe de
laïcité ne va pas de soi et l’interventionnisme de
l’Etat dans les affaires religieuses est patent.
Ainsi les temps sont durs et l’avenir incertain
pour les grecs-orthodoxes de Turquie qui se trouvent confrontés
à d’énormes difficultés pour construire
ou rénover églises et bâtiments religieux ; ils
subissent tentatives de spoliation de leurs biens fonciers et tracasseries
administratives, les hauts fonctionnaires de l’Intérieur
et de la Justice affichant sans vergogne leur hostilité aux
chrétiens. Enfin, les grecs-orthodoxes ne peuvent plus assurer
la formation théologique de leur clergé depuis que le
séminaire de l’île d’Halki, au large d’Istanbul,
a été fermé arbitrairement par les militaires
en 1971, à l’époque des tensions entre Grèce
et Turquie sur la question chypriote. Lieu de recherche en même
temps que faculté et lycée, il était l’un
des hauts lieux du monde orthodoxe et formait des étudiants
venus de Turquie mais aussi des Balkans, de Grèce, de Russie...
Les études de théologie se font désormais à
Athènes ou Thessalonique.
Le 7 octobre dernier, une attaque à la bombe
artisanale frappait le patriarcat orthodoxe d’Istanbul ; un mois
plus tôt, les ultranationalistes turcs avaient organisé
de violentes manifestations contre le patriarche œcuménique
Bartholomé Ier, chef spirituel du monde orthodoxe, qui réside
à Istanbul et il a été récemment empêché
de se rendre à une invitation de l’ambassade des Etats-Unis.
B. Europe/Turquie : Une question de “ valeurs
”
Ces atteintes graves
et répétées à la liberté de culte
et des personnes ont été soulignées dans le rapport
du Commissaire européen à l’élargissement,
alors que s’amorçaient les discussions avec la Turquie
sur son éventuelle intégration dans l’espace européen.
Pourtant, la majorité des responsables chrétiens de
Turquie reconnaissent un changement d’attitude de la part d’Ankara
et son désir d’intégrer l’Europe n’est
y sûrement pas étranger... Ainsi, la nouvelle loi foncière
garantissant les actes de propriété des Eglises chrétiennes
a enfin été promulguée et l’on avoue avoir
quelque espoir pour la réouverture du séminaire d’Halki.
Il reste à passer aux actes ! La Conférence des Eglises
européennes(1) rappelait dans son bulletin Monitor que ce qui
sépare la Turquie de l’Europe n’est pas une affaire
de “ religion ” mais de “ valeurs ”. L’Union
européenne est une communauté d’Etats basée
sur les “ valeurs de justice et de paix, de solidarité
et de pluralisme, de liberté d’expression et de respect
mutuel. Au stade actuel, on ne voit pas que ces valeurs soient exprimées
de la même manière en Turquie ”
C. Les chrétiens en Turquie
La Turquie compte
actuellement moins de 3500 grecs-orthodoxes dont 2000 dans l’ancienne
Constantinople (Istanbul). Selon des estimations avancées par
l’Union européenne, les autres chrétiens seraient
moins de 90 000, dont 60 000 Arméniens turcs majoritairement
présents à Istanbul. Lors de la crise chypriote et de
l’expulsion massive des Grecs de Turquie qui s’ensuivit,
les autorités turques recensaient 200 000 chrétiens
dont 100 000 à Istanbul.
D. Un islam européen ?
La Turquie dans l’Union
européenne, c’est l’espoir d’un pont jeté
entre les mondes musulman et chrétien. Mais “ l’islam
ne sera pas pleinement intégré en Europe tant qu’il
n’aura pas effectué une rupture complète entre
le religieux et l’Etat, comme le catholicisme romain a dû
le faire après la Révolution française”,
affirme l’une des personnalités catholiques européennes,
le cardinal belge Godfried Danneels. Il faut aussi que les musulmans
soient prêts “ à interpréter le Coran de
manière plus libre, comme nombre de chrétiens le font
pour la Bible ”. 
Claudine
Castelnau
1. La Conférence des Eglises européennes (KEK) rassemble
125 Eglises d’Europe, orthodoxes, protestantes, anglicanes
et vieilles catholiques.
