|

Numéro 186 - Févier 2005
( sommaire
)
 Regarder, Écouter, Lire
Regarder, Écouter, Lire
Livre : Le christianisme, quel impact aujourd’hui
?
La collection « Questions de vie », dirigée par
le pasteur Alain Houziaux, publie régulièrement de petits
livres permettant de retrouver les débats entre les orateurs
des conférences de l’Étoile. Ainsi Évangile
et Liberté a reçu récemment Le christianisme,
quel impact aujourd’hui ?
Sur ce thème, le cardinal Lustiger affirme qu’il existe
une culture chrétienne universelle, née de la liberté
donnée par l’Esprit à travers le baptême
et appuyée sur la foi en l’incarnation du Fils de Dieu.
Alain Duhamel retrace le rôle des religions dans l’histoire
de l’Europe et au sein d’un état laïc. Pierre
Joxe situe la problématique de leur expression aujourd’hui,
y compris celle de l’islam. Olivier Abel se demande quel est
l’apport de la religion face à la politique et à
la culture : plainte tragique et morale ou promesse prophétique.
 Très
dense et pouvant sembler un peu pessimiste, la contribution de Paul
Ricœur retient particulièrement l’attention : l’auteur
sent une tension exister entre la vocation des chrétiens qui
tentent d’agir dans notre société non-chrétienne
et celle de ceux qui s’isolent dans des communautés-refuges
d’où ils apportent un témoignage prophétique. Très
dense et pouvant sembler un peu pessimiste, la contribution de Paul
Ricœur retient particulièrement l’attention : l’auteur
sent une tension exister entre la vocation des chrétiens qui
tentent d’agir dans notre société non-chrétienne
et celle de ceux qui s’isolent dans des communautés-refuges
d’où ils apportent un témoignage prophétique.

Bernard Félix
Le christianisme, quel impact aujourd’hui ? Ouvrage collectif
sous la direction d’A. Houziaux avec O. Abel, A. Duhamel, P.
Joxe, J.-M. Lustiger, P. Ricœur. Paris, L’Atelier , 2004,
119 p.
 haut haut 
Livre : Qumran : un roman sur les origines du christianisme
Lors des Journées libérales
d’Agde 2004 consacrées aux origines du christianisme,
quelqu’un a fait allusion au roman d’Eliette Abécassis
intitulé tout simplement Qumran. C’est que ce livre, effectivement,
est riche de toute une information fort bien fondée sur les
problèmes que posent les origines du christianisme et sur les
différentes hypothèses qui ont cours à cet égard.
Certaines d’entre elles remettent d’ailleurs fondamentalement
en question des croyances que l’on pouvait tenir pour acquises,
par exemple sur l’originalité de Jésus. C’est
à lire, ne serait-ce que pour s’en trouver agréablement
informé.
Quand les textes de Qumran, dits aussi Manuscrits de la Mer Morte,
ont été découverts, l’establishment chrétien
s’est en général empressé d’affirmer
qu’ils ne remettaient pas en cause ce que l’on savait de
Jésus. D’autres, au contraire, se sont demandé
si Jésus et ses disciples ne seraient pas issus de la communauté
(on la qualifie volontiers de secte) des Esséniens qui vivaient
justement sur le site aride de Qumran.
Eliette Abécassis a eu l’idée de faire de ces
controverses la matière même de son roman, qui est presque
un « polar ». Ary, son personnage central, est un jeune
juif issu d’une yéshiva, l’une de ces écoles
talmudiques particulièrement rigoristes et orthodoxes. Son
père est un archéologue israélien, mais athée.
Ensemble, ils se trouvent chargés de retrouver un rouleau de
Qumran que des collaborateurs du Saint-Office pourraient voir dissimulé
pour préserver la vérité catholique. Il y a des
morts, de curieuses crucifixions, de nombreux rebondissements. On
évolue dans le monde des archéologues, des congrès
scientifiques, des chercheurs indépendants, et en même
temps on ne cesse de rencontrer les milieux juifs les plus orthodoxes.
Eliette Abécassis excelle à nous faire entrer dans les
démarches de la mystique hassidique, avec ses danses confinant
à l’extase. Et elle connaît l’art de tenir
son lecteur en haleine, sauf dans les dernières pages où
le récit tend à s’effilocher et se perdre dans
des invraisemblances, à moins que l’invraisemblable ne
soit ici une sorte de clin d’œil complice et narquois, une
manière d’inciter son lecteur à garder ses distances
envers tout ce monde d’hypothèses et de recherches. 
Bernard Reymond
Qumran. Paris, Le Livre de poche, 1998, 480 p.
 haut haut 
Livre : Une société en chantier
 Ce
livre de F. Vouga (professeur de Nouveau Testament à Montpellier
puis en Allemagne) est une sorte de commentaire de l’épître
aux Éphésiens de Paul, mais il n’est pas présenté
de façon habituelle. Partant de l’idée souvent
admise que cette épître n’est pas de Paul, mais
a trouvé naissance dans une des premières communautés
chrétiennes où Paul est passé, l’auteur
met en scène une situation romancée, imaginant ceux
qui seraient à l’origine de cette épître
; nous les suivons donc dans leur travail d’élaboration
d’un texte théologique dans la lignée de l’enseignement
qu’ils ont reçu de Paul. Ce
livre de F. Vouga (professeur de Nouveau Testament à Montpellier
puis en Allemagne) est une sorte de commentaire de l’épître
aux Éphésiens de Paul, mais il n’est pas présenté
de façon habituelle. Partant de l’idée souvent
admise que cette épître n’est pas de Paul, mais
a trouvé naissance dans une des premières communautés
chrétiennes où Paul est passé, l’auteur
met en scène une situation romancée, imaginant ceux
qui seraient à l’origine de cette épître
; nous les suivons donc dans leur travail d’élaboration
d’un texte théologique dans la lignée de l’enseignement
qu’ils ont reçu de Paul.
Cette fiction a un avantage : elle permet d’abord de bien faire
comprendre comment les choses ont pu se passer et comment des chrétiens
fidèles à Paul ont pu, sans vouloir faire de «
faux », élaborer un texte apocryphe. Ensuite, en imaginant
le travail d’élaboration des auteurs de l’épître,
nous découvrons ce qu’ils ont pu vouloir dire, la cohérence
du texte, et les enjeux qu’ils ont pu vouloir exprimer.
Cela nous donne un livre facile et agréable à lire,
qui comporte une apparente simplicité. Mais il ne faut pas
s’arrêter à cela. C’est une véritable
thèse, celle d’un des grands spécialistes du Nouveau
Testament, sur la nature de cet écrit, sur sa fonction et sur
son message, qui nous est donnée. 
Louis Pernot
François Vouga : Une société en chantier.
Chrétiens au coeur de la mondialisation selon l’épître
aux Éphésiens. Poliez-le-Gd, Éditions du Moulin,
2004, 90 p
 haut haut 
Cinéma : Religion d’amour
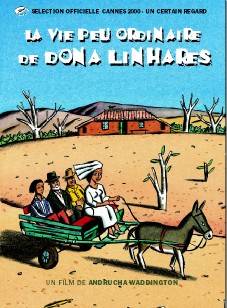 Une femme
enceinte, en robe de mariée, qui attend un mari qui ne vient
pas, seule devant une église déserte, dans un paysage
désolé. Image contradictoire à tout point de
vue. Une femme
enceinte, en robe de mariée, qui attend un mari qui ne vient
pas, seule devant une église déserte, dans un paysage
désolé. Image contradictoire à tout point de
vue.
Le mariage en blanc et à l’église relève
du rite religieux. Le blanc de la robe symbolise la pureté
de la jeune fille qui va se marier, symbole que l’évolution
des mœurs dans nos sociétés a vidé de son
contenu mais qui persiste envers et contre tout et en vient de ce
fait à désigner autre chose, à savoir l’affirmation
d’un changement de statut face à la société.
Le besoin d’une telle affirmation doit être important :
le prix d’une robe de mariée, qu’on ne porte en principe
qu’une fois, nous permet d’en mesurer la force. Ici la mariée
est enceinte ce qui souligne la contradiction.
Ensuite l’église. En principe elle est faite pour rassembler
les fidèles. Vide, elle aussi perd sa raison d’être.
Du rite proprement religieux ne reste plus rien, la religion est devenue
une coquille vide pour désigner l’usage social. Mais même
en tant que rite social, pour se marier il faut bien un mari. Ici,
le père de l’enfant n’a pas tenu sa promesse, et
le mariage n’a donc pas lieu.
Le paysage très pauvre, écrasé de soleil et de
vent, souligne encore la désolation de la situation.
Mais loin de tout désespoir, Darlene réussit malgré
tout à se bâtir une vie épanouie, à la
force du poignet et avec celle de son cœur si plein d’amour,
en se moquant des normes de la société, subverties par
une énergie débordante. Acceptant le mariage avec un
homme âgé, elle lui impose des amants successifs, installés
sous le même toit avec les enfants qu’elle a avec eux.
Des plans panoramiques des champs de canne à sucre où
elle travaille dur avec d’autres tâcherons, des plans rapprochés
des visages pleins de sueur et de poussière, ou encore des
images intimistes à l’intérieur de la maisonnée,
le film suit pas à pas la construction d’un univers où
l’amour l’emporte, véritable religion de la vie.

Waltraud Verlaguet
La vie peu ordinaire de Dona Linhares (EU, TU, ELES) de Andrucha
Waddington, Brésil (2000), sorti en DVD multizone sept. 2001,
v. f. en avr. 2003, distr en France par ID distribution, Paris,
www.iddistribution.com.
 haut haut 
Disque : Les leçons de musique de J.-F. Zygel
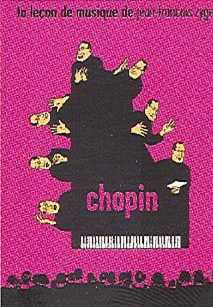 La
maison de disque Naïve a pris l’heureuse initiative d’éditer
en DVD les « leçons de musique » dispensées
par le pianiste-compositeur Jean-François Zygel. La
maison de disque Naïve a pris l’heureuse initiative d’éditer
en DVD les « leçons de musique » dispensées
par le pianiste-compositeur Jean-François Zygel.
En effet, depuis maintenant plus de sept ans, quelques
chanceux pouvaient assister à ces cours ouverts à tous
et se déroulant à la mairie du XXe arrondissement de
Paris. Devant le succès de cette initiative, France Culture
a accueilli ce concept sur son antenne. Mais aujour-d’hui, nous
pouvons retrouver quelques-unes de ces leçons consacrées
à Bartok, Chopin, Fauré ou Ravel.
Partant du constat que nombreux sont ceux que l’univers
de la musique classique effraie en raison d’un manque de connaissances,
J.-F. Zygel, jeune et brillant musicien s’inspirant des Young
People’s Concerts de L. Bernstein, analyse sans aucune pédanterie
et de façon vivante et didactique le langage de différents
compositeurs.
Sa démarche trouve ainsi un équilibre
entre le risque d’une trop grande technicité du propos
et celui de la simplification facile. Excellent pianiste, il illustre
son exposé d’exemples donnés seul au clavier, ou
en compagnie d’autres instrumentistes, en fonction du répertoire
abordé, permettant de ne pas perdre de vue que la musique demeure
avant tout une source de plaisir pour l’auditeur comme pour l’interprète.
En résumé, ces DVD intéresseront aussi bien le
néophyte que l’amateur éclairé. 
Matthieu Baboulène-Fossey
La leçon de musique de J.-F. Zygel (Naïve) :
– Bartók (musique populaire et savante)
– Chopin (Chopin et la mélodie)
– Fauré (L’horizon chimérique)
– Ravel (Le jardin féerique) !
 haut haut 
Merci de soutenir Évangile & liberté
en vous abonnant :)
|

|
|

