Il y a vingt ans, mourait Simone
de Beauvoir. On a inauguré à Paris en juillet dernier
une passerelle Simone de Beauvoir reliant la Bibliothèque François
Mitterrand au Parc de Bercy ; beau symbole que cette passerelle, sorte
de trait d’union entre les livres et la nature qui occupèrent
tant de place dans son existence. Les livres lui valurent le Prix Goncourt,
en 1954, avec Les Mandarins ; la nature, elle, donne à toute
son oeuvre une ferveur et une tonalité dominées par l’amour
de la vie et de la terre. Sur 37 ponts de la capitale, c’est le
seul, a-t-on dit, qui porte le nom d’une femme ; est-ce là
un hommage indirect à ce féminisme qui fut le sien et
qui a marqué notre époque ? Certes, mais n’oublions
pas le Pont Marie !
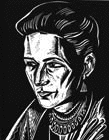 Vient
enfin d’être publié en poche son premier roman : Anne,
ou quand prime le spirituel (Gallimard, « Folio » 4360).
Le manuscrit inédit, refusé par Gallimard et Grasset en
1938, s’intitulait – pour plagier et moquer le titre d’un
livre fameux du philosophe Jacques Maritain – Primauté du
spirituel. Voilà un titre qui ne saurait nous laisser indifférents.
Ce roman, il est vrai, est déjà paru en 1979 ; il est
passé inaperçu et cela peut-être à cause
de son titre : Quand prime le spirituel. Le prénom (Anne) signale
désormais qu’il ne s’agit pas là d’un essai,
mais bien d’un roman. Ce dernier est constitué par cinq
nouvelles consacrées à autant d’héroïnes
(Marcelle, Chantal, Lisa, Anne et Marguerite) dont les destins se croisent
à travers l’ensemble du récit. Anne rappelle surtout
Elisabeth Lacoin (Zaza dans les Mémoires d’une jeune fille
rangée), morte à l’âge de vingt-deux ans, amie
d’enfance et de jeunesse de Simone de Beauvoir. « Encéphalite
aiguë », dirent alors les médecins. Simone de Beauvoir
a toujours interprété cette mort comme la conséquence
ultime d’une vie écrasée, étouffée
et niée par le moralisme chrétien de sa famille et de
son milieu. Un sentiment de culpabilité et de révolte
l’habita profondément depuis ce jour : « J’ai
pensé longtemps que j’avais payé ma liberté
de sa mort. »
Vient
enfin d’être publié en poche son premier roman : Anne,
ou quand prime le spirituel (Gallimard, « Folio » 4360).
Le manuscrit inédit, refusé par Gallimard et Grasset en
1938, s’intitulait – pour plagier et moquer le titre d’un
livre fameux du philosophe Jacques Maritain – Primauté du
spirituel. Voilà un titre qui ne saurait nous laisser indifférents.
Ce roman, il est vrai, est déjà paru en 1979 ; il est
passé inaperçu et cela peut-être à cause
de son titre : Quand prime le spirituel. Le prénom (Anne) signale
désormais qu’il ne s’agit pas là d’un essai,
mais bien d’un roman. Ce dernier est constitué par cinq
nouvelles consacrées à autant d’héroïnes
(Marcelle, Chantal, Lisa, Anne et Marguerite) dont les destins se croisent
à travers l’ensemble du récit. Anne rappelle surtout
Elisabeth Lacoin (Zaza dans les Mémoires d’une jeune fille
rangée), morte à l’âge de vingt-deux ans, amie
d’enfance et de jeunesse de Simone de Beauvoir. « Encéphalite
aiguë », dirent alors les médecins. Simone de Beauvoir
a toujours interprété cette mort comme la conséquence
ultime d’une vie écrasée, étouffée
et niée par le moralisme chrétien de sa famille et de
son milieu. Un sentiment de culpabilité et de révolte
l’habita profondément depuis ce jour : « J’ai
pensé longtemps que j’avais payé ma liberté
de sa mort. »
Le but de cette narration est d’évoquer la jeunesse de
cinq femmes victimes de préjugés religieux, de conventions
sociales, de soumissions diverses où domine l’aliénation
religieuse : le présent et l’histoire sont sacrifiés
à la vie éternelle, le corps à l’âme,
la terre et l’univers matériel au Ciel et aux exaltations
mystiques. Une résignation et un morne destin s’annoncent,
éteignant par avance les promesses de l’aube. Une remarquable
prière (p. 203-209) est à cet égard, à savoir
celui d’une passivité fataliste, un modèle du genre.
Il ne s’agit pas là de condamner les valeurs, mais bien
les valeurs toutes faites, préétablies, imposées
et inculquées sans droit d’inventaire. « J’ai
voulu montrer seulement comment j’ai été amenée
à essayer de regarder les choses en face, sans accepter d’oracles,
de valeurs toutes faites », déclare Marguerite, à
la dernière page ; elle ressemble beaucoup à l’adolescente
que fut Simone de Beauvoir, résistant à une éducation
et à un christianisme qui signifiaient pour elle hypocrisies
religieuses, illusions et fuites, refus d’un monde que nous n’avons
pas choisi, mais dans lequel on peut se choisir et s’engager librement
en refusant d’évanescentes et confortables spiritualités
héritées.
Quand, en 1902, le pasteur Wilfred Monod publie un recueil de prédications
intitulé Sur ta terre (et non pas Vers le Ciel ! ), c’est
un christianisme social qu’il promeut, s’opposant alors et
déjà à cette religion désincarnée
rejetée par Simone de Beauvoir. 
Laurent
Gagnebin
On pourra lire : Laurent Gagnebin, Simone de Beauvoir
ou le refus de l’indifférence, Fischbacher, 1968 (épuisé),
préface de S. de Beauvoir conclue par « On me lira mieux,
vous ayant lu ».

