« Je ne peux
voir une souffrance sans me poser deux questions : quelle en est la
cause, et que puis-je faire pour y remédier ? ». Cette
préoccupation de William Booth, pasteur méthodiste anglais,
explique pourquoi le mouvement qu’il a fondé embrasse de
par le monde un si large faisceau d’activités.
Pour William Booth, l’Évangile est une énergie
capable de transformer la vie de tout homme. Révolté par
la misère des populations ouvrières en pleine révolution
industrielle, il prêche dans la rue, dans des arrière-salles
de bistrot ou sous un chapiteau de cirque. Joignant le geste à
la parole, il fait ouvrir des abris pour des centaines de miséreux
et apporte des réponses concrètes à leurs besoins.
Son action se résume en trois mots : « Soupe, savon, salut
». Pour encadrer et mettre à l’œuvre les nouveaux
convertis, il structure le mouvement de façon hiérarchique
: « l’Armée du Salut » est née.
Le mouvement essaime rapidement au-delà des frontières.
Catherine Booth, fille du fondateur, débarque en France en 1881.
Entre 1917 et 1934, les « commissaires » Albin et Blanche
Peyron donnent à l’organisation un essor remarquable. Le
couple prêche Jésus-Christ, Sauveur des hommes, et se lance
dans la création d’institutions sociales novatrices, à
Paris (Palais de la Femme, Cité de Refuge…) et en province.
L’action menée en Guyane française aboutit à
la suppression du bagne.
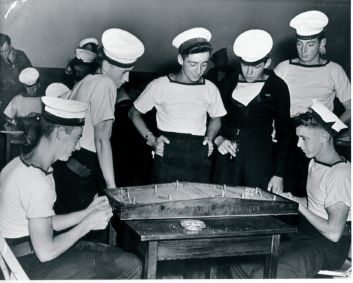 Pendant
la Seconde Guerre mondiale, l’Armée du Salut est interdite.
Marc Boegner, président du Conseil national de l’Église
réformée de France, obtient du gouvernement de Vichy que
les officiers soient intégrés à l’ERF comme
évangélistes, et que les établissements soient
rattachés à l’Association des Diaconesses de Reuilly.
La paix revenue, l’Armée du Salut développe diverses
actions pédagogiques en faveur de la jeunesse. Après les
« Trente glorieuses », elle participe aux dispositifs de
lutte contre les exclusions (ex. : la création de la Banque alimentaire),
organise et gère des structures d’accueil d’urgence
en partenariat avec d’autres associations et avec les pouvoirs
publics.
Pendant
la Seconde Guerre mondiale, l’Armée du Salut est interdite.
Marc Boegner, président du Conseil national de l’Église
réformée de France, obtient du gouvernement de Vichy que
les officiers soient intégrés à l’ERF comme
évangélistes, et que les établissements soient
rattachés à l’Association des Diaconesses de Reuilly.
La paix revenue, l’Armée du Salut développe diverses
actions pédagogiques en faveur de la jeunesse. Après les
« Trente glorieuses », elle participe aux dispositifs de
lutte contre les exclusions (ex. : la création de la Banque alimentaire),
organise et gère des structures d’accueil d’urgence
en partenariat avec d’autres associations et avec les pouvoirs
publics.
En 1994, de nouveaux statuts distinguent la gestion de
l’action sociale de celle de l’évangélisation.
Désormais, la Congrégation de l’Armée du Salut,
reconnue comme Église par la Fédération protestante
de France, poursuit la mission spirituelle. Ses postes d’évangélisation
sont des lieux où se manifeste aussi une solidarité concrète
en faveur de personnes ou familles en difficulté (aide alimentaire,
accompagnement, activités de loisirs pour les enfants). L’animation
de rue auprès d’enfants de quartiers difficiles à
Strasbourg, Mulhouse et Montbéliard se développe avec
le concours d’autres Églises et communautés.
De son côté, la Fondation gère 45
établissements sociaux et médicosociaux offrant des prestations
de qualité pour la réinsertion d’adultes en situation
d’exclusion, l’éducation et la prévention de
la violence auprès des jeunes, l’insertion professionnelle
de personnes handicapées mentales, ou l’accompagnement en
fin de vie de personnes âgées. « Secourir, accompagner,
reconstruire » résume sa mission, et celle plus générale
de toute l’Armée du Salut.
En hiver, l’action auprès des publics en
grande précarité est renforcée pour faire face
aux situations de détresse. Sans délaisser les missions
de plus long terme, elle tente d’offrir le minimum vital –
un repas et un lit – aux personnes qui en sont dépourvues.
À Paris, le service de repas dans la rue se poursuit même
toute l’année.
Au service de Dieu et des hommes, l’Armée
du Salut reste portée par des valeurs fortes, chrétiennes
et humanistes. Animée d’une volonté permanente d’adaptation
aux attentes de notre société, elle ne cesse de mettre
en œuvre des réponses innovantes. Pour l’heure, elle
affronte la saison hivernale avec des budgets de plus en plus tendus.

Robert
Muller

