Ouverture et Actualité
Actualité cinématographique
Sur cette page :
- Angel
- Les Témoins
- L’Italien
- Fragments sur la grâce
- Le dernier des fous
- Daratt, saison sèche
- Requiem
- Cœur
- Babel
- Les Fils de l'homme
- Indigènes
- Dunia
- Je vais bien, ne t'en fais pas
- Nausicaa de la vallée du vent
- Nos jours heureux
- Bled number one
Précédents articles sur un film :
Volver, Un regard sur le festival de Cannes 2006, The Secret Life of Words, C.R.A.Z.Y., Wassup Rockers, Le passager, Be With me, A Perfect Day, L’ivresse du pouvoir, Le Nouveau Monde , Un couple parfait, The King, Munich, Pompoko, Le secret de Brokeback Mountain, Good Night and Good Luck, Mary, The constant Gardener, Pour un seul de mes yeux, Le temps qui reste, Trois enterrements, Joyeux Noël, Free Zone, A history of violence, Match Point, Noces funèbres de Tim Burton, L'enfant, Caché, Gabrielle, Broken Flowers, Les Ames grises, Kilomètre zéro, Peindre ou faire l'amour, Les poupées russes, Sommeil amer, Le pont du roi St Louis, Last Days, Kingdom of heaven, Les yeux clairs, The taste of tea , In your hands, De battre mon cœur s'est arrêté , Palindromes, Million Dollar Baby, Va, vis et deviens , Private, Les tortues volent aussi , Moolaadé , La vie aquatique, La Petite Chartreuse , Je préfère qu'on reste amis , Mar Adentro, Le couperet .Angel
Réalisé par François Ozon avec : Romola Garai, Sam Neil, Michael Fassbender, Lucy Russel. Film France, UK, Belgique de 2007, durée 2h15, Sélection officielle Berlinale 2007.
Nous sommes en 1905, dans une petite ville d’Angleterre. Angel (Romola Garai), belle et énergique jeune fille, est la risée de ses camarades car c’est une artiste imbue d’elle-même et méprisante. Intelligente, elle a une imagination débordante et connaît un succès foudroyant dès son premier roman. Adulée, admirée, elle réalise tous ses désirs en imposant ses volontés : elle achète le manoir qui la faisait rêver quand elle sortait de l’école, elle épouse Esmé (Michael Fassbender), un noble déchu joueur et endetté, embauche sa sœur Nora (Lucy Roussell) comme secrétaire, s'entoure d'animaux,... Dans ce bonheur factice, Angel oublie la réalité qui l’entoure mais qui va la rattraper et la détruire.
Adaptation du roman éponyme de l’écrivain anglais Elisabeth Taylor, il s’agit du premier film entièrement tourné en anglais par Ozon. Il met en scène ce mélodrame sur un mode enthousiaste teinté d’humour en le plaçant dans un décor flamboyant et en utilisant des costumes chatoyants tel un clin d’oeil aux films hollywoodiens en technicolor. Le personnage central lui en donne l’occasion, le snobisme d’Angel et la négation de ses origines modestes la poussent à afficher un goût pour le kitsch et le tape à l’œil. Sa personnalité exubérante se révèle assez vite névrotique, elle n’est pas seulement la femme qui veut s’émanciper mais une manipulatrice snob qui joue de ses atouts pour la gloire car rien d’autre ne l’intéresse qu’elle-même. Elle met la main sur Nora et son éditeur, seule la femme de celui-ci (Charlotte Rampling) prend ses distances et la considère objectivement. Mais certaines situations amènent le spectateur à éprouver de la compassion d’indulgence à son égard. Si Angel attire l’attention tout au long du film, Nora n’en occupe pas moins une place importante. Discrète, elle est la clé de voûte sur laquelle s’appuient tous les personnages, y compris Angel, qui ressent quelques tentations saphiques.
Ozon nous fait part de ses réflexions sur une créatrice livrée (comme lui) à un succès populaire rapide et évoque l’angoisse liée à la pérennité de l’art. Cette histoire pourrait se dérouler à notre époque et le spectateur se demande si le cinéaste n’a pas introduit une part de son autoportrait dans cette réalisation.
Il appartient à chacun d’avoir son angle de lecture, sa version de l’allégorie de la célébrité et d’apprécier cette nouvelle réussite de François Ozon.
Pierre Nambot
Les Témoins
Réalisé par André Téchiné, avec Michel Blanc (Adrien), Emmanuelle Béart (Sarah), Sami Bouajila (Mehdi), Julie Depardieu (Julie), Johan Libereau (Manu)… De 2007, durée : 1h55.
Manu arrive à Paris et partage une modeste chambre d’hôtel avec sa soeur Julie. Dans un lieu de drague, il fait connaissance avec Adrien, un médecin, quinquagénaire et homosexuel, qui lui fait découvrir le style de vie de son milieu. Une amitié joyeuse mais chaste se noue entre eux. Adrien lui présente un jeune couple, Sarah et Mehdi, aux relations très libres et parents d’un tout jeune enfant. Deux événements inattendus bouleversent l’existence de Manu : sa relation passionnée avec Mehdi et sa contamination par le virus du sida. Au début des années 80, le sida est perçu comme une peste moderne, une maladie honteuse qui bouleverse le tranquille agencement de ces destins particuliers. Chacun devient acteur et témoin d'un drame contemporain où ceux qui ne meurent pas n’en ressortent pas indemnes.
André Téchiné nous montre des personnages heureux de vivre, tout particulièrement Manu qui arrive de province et compte bien profiter de la liberté qui règne dans la capitale. De belles scènes touchantes représentatives de la soif de vivre illustre l’insolence de la jeunesse. Ces scènes sont emblématiques de l’insouciance d’une jeunesse incapable de pressentir le danger de cette maladie mortelle qui détruit brutalement la vie de tous ceux qui y sont confrontés, les malades et leurs entourages. Par contraste, Adrien assez solitaire, plus réfléchi du fait de son âge et de son métier, s’interroge sur le devenir de ceux et de celles qui l’entourent.
La mise en scène est admirable et les mouvements tantôt fluides tantôt heurtés de la caméra associés à un montage approprié des plans séquences, accentuent l’aspect accidentel des rencontres et la force des pulsions des personnages. C’est un télescopage social et culturel qui symbolise les courants de vie des années 80. Le réalisateur évite l’écueil du psychodrame et montre simplement, avec tendresse, les situations difficiles et les relations tendues avec autrui. Il nous permet de pénétrer avec finesse dans un drame passionnel ; le spectateur assiste médusé au subtil jeu de balancier entre la vie et la mort, entre la fin et le recommencement : « C’est un miracle de vivre ! ». Aussi talentueuse qu’harmonieuse, la distribution est dominée par Michel Blanc remarquable.
Un très beau Téchiné, un chef d’œuvre.
Pierre Nambot
haut

L’Italien
Réalisé par le Russe Andreï Kravchuk avec Kolya Spiridonov, Denis Moiseenko, Nikolai Reutov, Olga Shuvalova… Durée : 1h40.
L’un des nombreux pensionnaires d’un vétuste orphelinat russe, Vania, un garçon de 6 ans, refuse de suivre un couple d’Italiens aisés qui désirent adopter un enfant. Comme leur choix s’est porté sur lui, Vania est surnommé l’Italien. Un jour, une femme venue à l’orphelinat à la recherche de son fils, en est violemment chassée. Dès lors, Vania s’interroge : « Et si ma mère venait un jour me chercher ? ». Il décide de la retrouver.
Kravchuk nous présente l’orphelinat, isolé dans une campagne proche de la frontière finlandaise, comme figé dans la boue et la neige. Dans une ambiance austère, il parvient à nous rendre attachants les personnages tout en dénonçant la défaillance des adultes souvent impliqués dans un système mafieux où règnent prostitution et racket. Le cinéaste, qui a déjà réalisé un documentaire sur un orphelinat russe, mêle habilement réalité et fiction ; les enfants sont pour la plupart des orphelins, ce qui confère au film une authenticité encore plus poignante.
Dans la seconde partie du film, Vania s’enfuit de l’orphelinat pour partir à la recherche de sa mère. Il s’agit d’un véritable parcours initiatique pour Vania qui se comporte comme un tout jeune héros dont la détermination inaltérable force l’admiration. Animé d’un courage indéfectible, il surmonte les très nombreux obstacles qu’il rencontre car il est persuadé que « Le printemps arrive bientôt ». En effet, au fur et à mesure que le récit avance, les difficultés s’aplanissent, le ciel devient plus clément, plus lumineux, jusqu’au final imprégné de lumière.
« L’Italien » rappelle les films néoréalistes italiens et ce n’est sans doute pas un hasard, si le couple qui souhaite adopter l’enfant est de nationalité italienne. Kravchuk filme la Russie post-communiste comme Roberto Rossellini filmait le Berlin détruit de 1945 dans « Allemagne, Année Zéro ». La cruauté des orphelins livrés à eux-mêmes, dénués de repères, est particulièrement saisissante. La force du film tient à l’interprétation, notamment celle du tout jeune Kolia Spiridonov, qui incarne Vania avec une authenticité attachante, et à la sobriété avec laquelle la réalité sordide est présentée.
Kravchuk s’inspire d’un fait divers relatant l’histoire d’un jeune orphelin bien décidé à retrouver sa mère et d’une situation sociale qui amène de nombreux enfants à vivre dans la rue.
« L’Italien » est une oeuvre sur l’amour, la dignité et le respect de soi. « Je pense que si une personne agit selon son cœur et des principes humains, elle sera toujours gagnante dans n’importe quelle situation » dit Andreï Kravchuk.
Voici un film qui apporte bien plus de satisfaction que les blockbusters actuels dont parlent tant les médias..
Pierre Nambot
Fragments sur la grâce
Film français (sortie décembre 2006) de Vincent Dieutre, scénario de Vincent Dieutre et Laurent Roth. Avec Mathieu Amalric, Mireille Perrier, Francoise Lebrun, Eva Truffaut, Cyrille Pernet, Eugène Green. Musique : Plain-Chant Français des 17ème et 18ème siècles par l'ensemble Organum, direction Marcel Peres. Durée : 1h41
Film d’investigation consacré à Port-Royal et à la doctrine janséniste avec des incursions dans le Grand siècle, celui de Pascal et de Racine. J’aborde ici uniquement l’essentiel mais la densité des informations justifierait un développement plus important.
Le réalisateur se met en quête des événements et y entraîne le spectateur. Tout d’abord, il nous montre la vallée de Chevreuse où fut établie l’abbaye des femmes, puis l’insalubrité des lieux contraignit la communauté à s’installer à Paris en 1625 à l’Hôtel de Clagny. A cette occasion la direction religieuse fut confiée à l’abbé de Saint-Cyran, qui en fit le foyer du Jansénisme.
Ce mouvement religieux, influencé par la pensée de Saint Augustin, développée par Cornelius Jansen dans « l'Augustinus », fit à l'époque l'effet d'une bombe. La Grâce et la Liberté furent les premiers sujets de controverse puisque le Jansénisme s’inspirait des idées de la Réforme protestante, en particulier celle de la prédestination selon Calvin. Se sentant menacés dans leur pouvoir au sein de la plupart des cours européennes, les Jésuites furent particulièrement agressifs à l’égard du Jansénisme. Les divergences de ces deux tendances du catholicisme ne se limitèrent pas à cette polémique mais s’étendirent aux questions de la foi, de la raison, de l’austérité morale…
Le mouvement janséniste attira de grandes figures intellectuelles et artistiques, l’écrivain Jean Racine, le philosophe et scientifique Blaise Pascal…. C’en fut trop pour le pouvoir en place qui n’hésita pas à le décapiter. Mais ses idées ne disparaîtront pas et réapparaîtront au siècle suivant, celui des Lumières et de la Révolution.
Dieutre traite ici un sujet âpre, difficile, en variant les angles d’approche, en alternant paysages et entretiens, le film se transforme en une aventure historique et spirituelle. Il juxtapose les entretiens avec des spécialistes, par exemple avec Philippe Sellier, professeur émérite à la Sorbonne, les recherches en bibliothèque, la lecture dans le langage de l'époque, le commentaire à la première personne sur les conséquences politiques, l'architecture et la musique. Les nombreuses scènes de lecture, dans une pièce froide et nue, comme pour marquer le caractère contraignant de la vie monacale, sont saisissantes. De plus les comédiens se livrent à une présentation des textes religieux dans le Français de l’époque prononcé scrupuleusement, d’une façon à la fois personnelle et incarnée.
Il s’agit d’un film fascinant qui nécessite une mobilisation totale de notre attention pour suivre les développements historiques et théologiques mais la satisfaction finale n’en est que plus grande.
Pierre Nambot
Le dernier des fous
Film français de Laurent Achard, avec Julien Cochelin, Pascal Cervo, Annie Cordy, Fettouma Bouamari, Jean-Yves Chatelais, Dominique Reymond, de 2006. Durée 1 h 35. Prix Jean Vigo (2006) et prix de la mise en scène à Locarno (2006).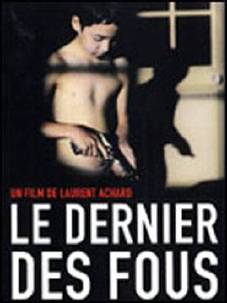
Ce sont les vacances. Martin, (Julien Cochelin) jeune garçon de onze ans, n'a pourtant pas l'air ravi. L’ambiance est lourde dans la ferme familiale. Sa mère (Dominique Reymond) ne quitte plus la chambre au premier étage refusant de voir quiconque, son frère, (Pascal Cervo) abandonné par son amant, sombre dans l'alcoolisme et la dépression, son père (Jean-Yves Chatelais) reste impuissant face à cette situation tant il est dominé lui-même par sa propre mère (Annie Cordy), une femme sèche et autoritaire. Dans ce chaos, seule l'intendante de la maison, Malika (Fettouma Bouamari), adoucit les angles et prodigue un peu d'affection à Martin. Irrémédiablement aspiré par la névrose ambiante, il en devient lui aussi une de ses proies.
Laurent Achard transpose dans la France rurale d'aujourd'hui un récit à l'origine situé dans la bourgeoisie canadienne des années 60, « The last of the crazy people » de Timothy Findley. "Ce qui m'a plu d'emblée dans le livre de Finley, c'est qu'il parvient par la simple évocation d'événements du quotidien à faire peser une menace sourde sur ses personnages sans que jamais on ne puisse précisément la définir", explique-t-il. "C'est cette faculté à savoir installer un climat oppressant, presque terrifiant, qui m'a donné envie d'en faire l'adaptation."
Au centre du film, Martin nous présente le monde selon son propre point de vue, unique et plutôt radical. Avec un talent remarquable, Laurent Achard utilise le mystère qu’inspire naturellement Julien Cochelin : sa démarche singulière, maladroite, son regard insistant, insondable, sa voix intrigante à peine audible. Le réalisateur place la caméra dans l’axe du regard de l’enfant qui observe à travers le trou d’une porte, d’une trappe de grange, d’une lucarne, le monde fou des adultes qui n’arrivent pas à régler leurs différends par le dialogue, dans cette famille on ne communique pas. Le spectateur est bouleversé par ce petit homme qui absorbe comme une éponge tout ce qui se passe et éprouve un ressentiment qui s’amplifie au fur et à mesure du déroulement de l’intrigue. Aucune note de musique, mais des effets sonores très étudiés qui induisent une violence pernicieuse, certes absente de l’image, mais qui n’en est pas moins traumatisante. Pour Martin, la ferme est une prison, l’enfer où règnent le rejet (de sa mère, de sa copine Jacqueline), la peur (de grandir, de mourir), la frustration (personne ne l'écoute), la douleur (celle du frère, muette, celle de la mère, féroce), la colère (d'être sans arrêt malmené et trompé) et enfin la haine déchaînée envers tous ceux qui, le cœur sec et vide, lui ont fait du mal.
« Le dernier des fous » est un film exceptionnel, rares sont les œuvres qui inscrivent à l’écran les terreurs enfantines avec autant de maîtrise. Il est éprouvant, dérangeant mais incontournable pour un cinéphile.
Pierre Nambot
Daratt, saison sèche
De Mahamat-Saleh Haroun (France – Belgique – Tchad – Autriche), avec Ali Bacha Barkaï, Youssouf Djaoro, Aziza Hisseine…De 2006, durée : 1h35. Prix spécial du Jury (Venise 2006).
Pour mettre fin à la guerre civile, le gouvernement tchadien décide d’accorder l’amnistie aux criminels responsables d’exactions. Dans un pays où le conflit a débuté en 1965 et a provoqué la mort de 40000 personnes, les plaies sont difficiles à cicatriser. Ne pouvant pas accepter cette amnistie, un grand-père envoie son petit-fils Actim, tuer l’assassin de son père, Nassara, ancien criminel de guerre.
Actim se rend à N’djamena et ne tarde pas à trouver Nassara quelle surprise ! Il s’attendait à être confronté à un monstre, le voici face à un vieil homme, un bienfaiteur à la stature chancelante, un boulanger de son état, qui distribue gratuitement du pain aux enfants.
Pour autant, Actim n’oublie pas sa mission et se fait embaucher pour l’accomplir dans de bonnes conditions. Le visage fermé par la haine et le désir de vengeance, il parle peu. A plusieurs reprises, il s’empare du revolver mais n’arrive pas à passer à l’acte comme s’il avait peur de commettre l’irréparable. Nassara lui apprend le métier de boulanger et éprouve peu à peu de l’amitié pour le jeune homme au point de lui demander de devenir son fils adoptif. Actim décide alors de le conduire auprès de son grand-père…
Très souvent exploité, le thème de la vengeance associé à la haine fait l’objet de nombreux films : « Crossing Guard » de Sean Penn, dans lequel un père de famille attend la sortie de prison de l’homme responsable de la mort de son fils, « Le Fils » des frères Dardenne, où le père se rapproche peu à peu de l’adolescent coupable de la mort de son fils…
Conscient de cette universalité, Haroun réalise son 3ème long métrage de fiction avec la volonté d’inscrire son récit dans le contexte tchadien. Il traite ce sujet avec beaucoup de maîtrise en posant la question du principe de vengeance comme acte juste, équitable, tout en soulignant que le pardon vient plus facilement des jeunes. Il aborde aussi avec beaucoup de finesse les relations père-fils, l’injustice, l’impunité, les ravages de la guerre et la rédemption.
Le cinéaste filme en gros plan les personnages et poursuit minutieusement les expressions des visages et les gestes qui traduisent d’une manière saisissante les sentiments de haine, d’hésitation, de confusion. Peu de paroles et de musique, il règne souvent un silence de mort qui suscite de très fortes émotions. Le tout se déroule dans un cadre frappé par la sécheresse, sécheresse climatique, bien sur, mais aussi aridité symbolique d’un pays plongé dans le chaos .
C’est un très beau film rempli de compassion et porteur d’espoir.
Pierre Nambot
haut

Requiem
Film allemand de Hans-Christian Schmid avec Sandra Hüller, Burghart Klaussner, Imogen Kogge. De 2006, durée 1 h 33.
Ce film s’inspire d’un fait divers qui s’est déroulé en Allemagne au début des années 70. Michaela (Sandra Hüller) vit avec ses parents et sa sœur dans un village près de Tübbingen, ville universitaire, où l’Eglise Catholique détermine le moindre agissement des paroissiens. Apparemment sans problème, cette jeune fille est néanmoins sujette à des troubles assimilés à de l’épilepsie. A cause de son état de santé, ses parents, très croyants, veulent la protéger mais l’étouffent sous un carcan d’interdits. Le comportement possessif de sa mère, les regards permanents et inquiets de son père l’obsèdent… Déchirée entre sa famille, sa foi et la maladie, Michaela cache ses crises car elle en a honte. Elle entreprend des études à Tübbingen et pense pouvoir s’affranchir ainsi des pressions détestables de sa mère en vivant librement sa jeunesse. Loin d’une famille conditionnée par un catholicisme aliénant et dominée par une mère qui refuse toute forme d'émancipation, elle découvre la douceur de la vie étudiante, le rock, l'alcool, l’amitié, l’amour, l’athéisme. Mais ses crises reviennent plus intenses sans que nous puissions en déterminer la cause. S’agit-il d’un problème épileptique, psychiatrique ou d’un phénomène de possession ?
Hans-Christian Schmid reste dans l’ambiguïté, il nous considère comme témoins de terribles scènes : persuadée d’entendre des voix, Michaela ne parvient pas à toucher le Christ en croix accroché au mur de sa chambre, elle pousse des cris de possédée, se roule par terre, tremblante… Le changement de vie n’a rien résolu, tout s’effondre pour la jeune fille qui décide de rentrer chez elle. C’est un point de non retour qui marque « sa descente aux enfers ». Les crises d’hystérie de révolte et de haine envers sa mère atteignent leur paroxysme. Elle est prise d’épouvante lorsqu’elle voit des prêtres ou des symboles religieux. Elle a recours à une série de séances d’exorcisme mais elle y perd la vie.
La mise en scène très sobre présente le sujet sous un aspect quasi-documentaire. Requiem est avant tout le portrait d’une époque et d’un milieu où le « qu’en dira t’on » règne en maître, où l’Eglise Catholique impose un mode de vie reclus et exerce une oppression en guise de ferveur. Totalement aliénés par leur croyance aveugle, les parents sont aussi victimes de nombreux préjugés. La jeune fille porte en elle toute la complexité de cette situation et affronte différents pouvoirs : maternel, familial, religieux. Perdue, écrasée, elle appelle au secours et demande à être aimée : « Jure moi de ne jamais m’abandonner » supplie-t-elle son ami. Personne ne la comprend et personne ne lui apporte ce dont elle a besoin.
Les décors sont minutieusement choisis pour restituer fidèlement l’événement dans son époque, le choix musical pertinent n’est jamais superfétatoire. Tous les comédiens sont excellents, spécialement Sandra Hüller dans le rôle de Michaela qui mérite pleinement l’Ours d’argent de la meilleure actrice au festival de Berlin 2006.
Requiem est une tragédie d’autant plus impressionnante qu’elle découle d’un fait réel et qu’elle appelle à la réflexion sur des modes de pensée et des événements de même nature qui existent encore aujourd’hui : l'étroitesse d'esprit, la superstition religieuse, le retour de rituels moyenâgeux…
Il s’agit d’une oeuvre intéressante par les réflexions qu’elle engendre et les questions qu’elle suscite mais éprouvante pour les âmes sensibles.
Pierre Nambot
haut

Cœurs
Film d'Alain Resnais (France), avec André Dussollier, Isabelle Carré, Lambert Wilson, Laura Morante, Pierre Arditi, Sabine Azéma, de 2005, durée 2h05. Il a obtenu le prix de la mise en scène au festival de Venise 2006.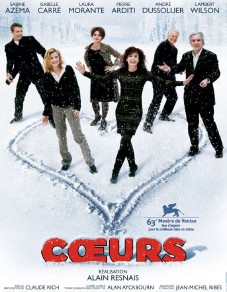
Ce film est une adaptation de la pièce « Private Fears in public places » d’Alan Ayckbourn, un auteur que le cinéaste a déjà adapté au cinéma avec « Smoking/No Smoking », en 1993.
Les personnages apparaissent comme des individus ordinaires, peu attrayants, solitaires, enfermés dans leurs habitudes et leurs appartements plutôt « kitsch » : un couple morne recherche un logement, un agent immobilier vit avec sa sœur, un barman dont le père est malade...
Dès le début, un malaise s’installe. Le spectateur éprouve l’étrange impression que le film est mal engagé, il se rassure néanmoins en pensant à la notoriété du réalisateur. A juste titre, car les apparences et le trouble s’effacent, la superficialité des premiers instants s’estompe progressivement pour faire place à une attente angoissante sur le devenir des personnages. Peu à peu leur situation délicate se dessine. Pour le couple rien ne va plus : Dan (Lambert Wilson), chômeur désabusé s’enivre, Nicole (Laura Morante) renonce à chercher un grand appartement, elle décide de partir et de vivre chichement. Thierry (André Dussolier), l’agent immobilier, vit avec sa sœur Gaëlle (Isabelle Carré) qui rêve encore au prince charmant ; il travaille avec Charlotte (Sabine Azéma), une bigote au comportement érotique surprenant. Lionel (Pierre Arditi), le barman, veuf inconsolable, héberge son vieux père irascible et obsédé sexuel.
Resnais nous dit : « J’ai eu tout de suite cette vision des sept personnages pris dans une toile d’araignée, je dirai même que je la voyais au crépuscule sur une lande bretonne. L’araignée n’est pas là, elle est partie, mais dès qu’un insecte bouge, essaye de se dégager, la toile vibre, et un autre insecte qui n’a rien à voir avec le premier en est affecté... » Il filme ainsi le ballet nostalgique de ces êtres au cœur lourd, avec une élégance et un raffinement qui nous sidèrent. Chaque plan est construit comme un tableau au centre duquel une pauvre condition humaine se débat. La neige omniprésente crée une atmosphère feutrée, les bruits de pas, les voix sont atténués… Le spectateur s’abstient de rire des situations cocasses de peur d’avoir ensuite à en pleurer.
Resnais nous amène ainsi progressivement au cœur de son sujet : la solitude, l’isolement, le regard de l’autre, l’angoisse de la disparition et de la mort, il ne faut jamais renoncer à améliorer les choses, à rencontrer l’amour, l’existence vaut la peine d’être vécue.
« Cœurs » est vraiment un très beau film !
Pierre Nambot
haut

Babel
Film de 2006 réalisé par le mexicain Alejandro González Iñárritu avec Brad Pitt, Cate Blanchett, Koji Yakusho et Gael García Bernal. Durée : 2 h 23.
Babel a reçu le Prix de la mise en scène et le Prix du Jury Œcuménique au 59ème Festival de Cannes.
Quatre histoires se déroulent dans des pays différents : les Etats-Unis, le Maroc, le Mexique, le Japon et la Tunisie. Un simple coup de fusil tiré par deux jeunes provoque des événements dramatiques et bouleverse plusieurs vies : celle d’un couple américain (Brad Pitt et Cate Blanchett) en voyage pour rétablir leurs liens conjugaux, d’une gouvernante mexicaine (Adriana Barraza), qui conduit les enfants américains dont elle a la charge au mariage de son fils au Mexique, d’une jeune fille japonaise sourde-muette en situation de grande souffrance morale. Des liens ténus se tissent peu à peu entre ces quatre récits qui finiront par s’assembler avec l’intervention de nombreux personnages aux prises avec de multiples péripéties.
L’entrecroisement de ces destinées, très éloignées les unes des autres, pourrait faire apparaître le film comme une illustration de la théorie « du battement de l’aile du papillon » : une action localisée a des conséquences mondiales importantes. Cependant, une connaissance élémentaire de la culture chrétienne nous amène à constater que cette théorie n’est pas le véritable thème du film. Par le titre, le réalisateur annonce d’entrée de jeu que la relation entre la mosaïque des récits et le mythe biblique constitue le fondement même de son œuvre : « Allons descendons et là confondons leur langage afin qu’ils n’entendent plus la langue les uns des autres . Et l’Eternel les dispersa sur la face de toute la terre… » (Genèse 11, 7 et 8).
Jouant à la fois sur les images, les discours et les sons, Iñárritu met en évidence le fractionnement du monde actuel. Si la transmission de l’information n’est plus tributaire de la distance, puisque la communication est maintenant quasi immédiate entre deux points très éloignés du globe, elle reste difficile voire impossible entre des proches. Ainsi l’annonce de l’assassinat d’une américaine par des terroristes provoque l’abandon de cette dernière par le groupe de touristes auquel elle appartient. La communication est absente tout autant des espaces « vides », désertés par les hommes, que des lieux où règne la suractivité. Plus que d’incommunicabilité il s’agit de surdité au monde et aux autres. Comment ne pas être étonné par l’analyse de certains critiques à Cannes qui ont estimé que les séquences relatives à la jeune sourde-muette « est une pièce rapportée inutile au film» alors qu’elle en constitue la métaphore centrale !...
A ce thème central s’ajoutent des réflexions sous-jacentes tels les préjugés culturels et raciaux, le pouvoir de l’argent, la manipulation…
Comme à son habitude, le réalisateur ne s’en tient pas à un seul fil narratif mais au contraire, il déstructure son œuvre pour être en symbiose avec l’aspect chaotique du monde. Le prix de la mise en scène est hautement mérité, et les interprétations de Brad Pitt et de Gael Garcia Bernal sont poignantes et remarquables.
C’est un très beau film hélas bien pessimiste sur le destin des hommes incapables d’aller au-delà d’eux-mêmes et dont l’état d’esprit constitue les barreaux de leur propre prison.
Après BABEL, qui termine sa trilogie à la suite de « Amours Chiennes » et de « 21 grammes », espérons qu’ Iñárritu réalisera une œuvre qui nous ouvrira des perspectives humaines plus optimistes.
Pierre Nambot
haut

"Les Fils de l'homme"
Film (UK/USA) de 2006 réalisé par le mexicain Alfonso Cuaron, avec Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Claire-Hope ; durée 1 h 50.
Nous sommes en 2027, non seulement l'homme a épuisé toutes les ressources de la planète mais il est devenu stérile : aucune naissance n'est survenue depuis 18 ans. Le désespoir a envahi le monde où règnent la violence, l'anarchie et le nihilisme. Seule, la Grande Bretagne a évité cette descente aux enfers grâce à un régime totalitaire. Elle attire des milliers de réfugiés et les parquent dans des camps.
Théo, qui a perdu son fils lors d'une épidémie planétaire, se laisse aller et vit entre hallucination et ivresse. Julian, clandestine d'un mouvement terroriste important, l'oblige à aider Kee, une jeune immigrante, enceinte. Cette dernière représente l'unique espoir du genre humain mais elle a des ennemis…
Cinéaste mexicain, pour le moins éclectique, Cuaron a produit des films aussi différents que « Y tu mama tambien », film touchant sur une « virée » entre ados et « Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban», le meilleur de la série. En s'inspirant du livre éponyme de PD James, il réalise ici un film d'anticipation et nous plonge avec brutalité dans une société nihiliste où le terrorisme s'impose au quotidien. Pas de technologie sophistiquée dans ce monde, seulement des écrans numériques, mais une publicité omniprésence, la pilule Quietus qui permet le suicide en douceur à ceux qui ne peuvent pas vivre sans espoir, des injonctions « Ne pas faire de tests de fertilité est un crime », des actualités alarmantes relatent les combats, les explosions des bombes …
Dans ce monde apocalyptique évolue Théo, un anti-héros, joué par le charismatique Clive Owen. Entraîné contre son gré dans l'aventure, c'est un homme usé, déprimé, alcoolique, sarcastique qui pourtant suscite la compassion. Jasper, son vieil ami, un ex-hippie touchant, réfugié dans les bois, se sacrifie pour lui sauver la vie. Les animaux (chats, chiens, moutons, vaches) pullulent et semblent narguer l'homme en affichant une grande vitalité.
Cuaron tourne presque tout le film en plans séquences pour garder un souffle, un rythme accéléré. La caméra à l'épaule du talentueux Lubezki suit la fuite de Théo et de sa protégée tel un reportage sur le terrain. Les images évoquent, avec une force singulière, les scènes de guerre d'une violence insoutenable banalisée par la télévision. Le malaise du spectateur est d'autant plus grand qu'il voit ce futur comme l'issue probable des problèmes actuels : terrorisme, mouvements migratoires incontrôlables, régime totalitaire qui maintient l'ordre. Le réalisateur parvient à rendre la campagne anglaise terrifiante en accentuant la grisaille de l'hiver. Une musique nostalgique et poignante complète cette ambiance lugubre.
Toutefois, le réalisateur introduit quelques éclairs de félicité dans ce climat cauchemardesque : la lumière troue brièvement le voile opaque et terne qui englobe tout, des animaux alertes traversent le cadre, l'armée se sépare en deux, comme la Mer rouge devant Moïse, pour laisser passer l'enfant du miracle avant de reprendre le combat, telle une parenthèse qui s'ouvre et se referme…
C'est un grand film d'action qui s'inscrit dans une politique fiction relative au futur de notre humanité. Cuaron ne nous laisse cependant pas sans espoir puisqu'il s'appuie sur des mythes fondateurs en les détournant : naissance d'un « Jésus fille » noire, Moïse sauvé des eaux. Il essaie de donner un souffle biblique qui touche discrètement à la grâce.
Cette œuvre intéressante mais éprouvante sur le devenir de l'humanité ne laisse pas indemne le spectateur.
Pierre Nambot
Indigènes
Film français, marocain, algérien et belge réalisé par Rachid Bouchareb, avec Jamel Debbouze, Sami Bouajila, Roschdy Zem, Samy Naceri, Bernard Blancan. Durée : 2h08.
Il m'est apparu d'autant plus nécessaire de parler de ce film, dont le thème nous concerne tous, qu'une importante campagne médiatique bat son plein depuis sa sortie sur les écrans.
Rappelons qu'en 1944-1945, après la campagne d'Italie, la libération de la Provence, des Alpes, de la vallée du Rhône, des Vosges et de l'Alsace a participé pour une large part à la victoire des Alliés et a permis à la France de se trouver dans le camp des vainqueurs lors de la signature de l'Armistice. Cette libération a été le fait de la 1ère Armée française, formée en Afrique loin de la surveillance des commissaires Allemands et des fonctionnaires de Vichy. Elle comptait 200 000 hommes constitués de 130 000 "indigènes" soit 110 000 Maghrébins et 20 000 Africains, ainsi que 50 000 pieds-noirs et 20 000 jeunes résistants de la métropole ayant fui l'occupation.
Le film nous conte l'histoire oubliée des "indigènes" et tout particulièrement l'épopée de quatre Maghrébins qui font preuve d'endurance, de courage et d'un sens inné du terrain. Chacun d'eux poursuit un objectif pendant cette difficile traversée de la France.
Le spectateur est placé devant des scènes de guerre présentées grandeur nature et aussi réelles que possible par Bouchareb. Tous les moyens techniques sont utilisés : crépitement des mitrailleuses, explosion des grenades, intervention des chars, écroulement des victimes… La mise en scène est trépidante pour transcrire la férocité des combats mais délicate quand il s'agit de susciter des émotions comme, par exemple, lorsque nos héros sont en danger de mort ou bien victimes d'injustice et de brimades. Si quelquefois le réalisme des scènes est discutable, les personnages un peu stéréotypés et pas toujours convaincants, le réalisateur se rattrape par un discours sincère, humaniste et courageux.
Rachid Bouchareb ne réalise pas une reconstitution historique, il nous invite à penser à tous ceux qui se sont battus pour la France mais n'ont eu, ni les mêmes droits que les soldats originaires de la métropole, ni la reconnaissance méritée. Il manifeste ici un besoin de vérité et de justice car, même s'il n'évoque pas directement la question, le montant dérisoire des pensions versées à ces anciens combattants « indigènes lui parait, à juste titre, particulièrement inique.
Il restitue également l'ambiguïté des personnages déchirés entre leur identité nord-africaine et la nécessité de faire état d'une nationalité strictement française.
Que cela soit voulu ou non, le film « Indigènes » arrive à point nommé, à un moment où les minorités ethniques revendiquent une place dans notre société et où le racisme toujours présent rend compte des difficultés d'une nation qui ne parvient pas à intégrer ses immigrés, ni à les faire adhérer à son concept de république laïque. C'est dans ce contexte tourmenté, que la France se penche sur son passé colonial et débat de discrimination positive et d'immigration choisie.
« Indigènes » est un film à voir, davantage pour les messages d'actualité qu'il véhicule et suggère que pour son aspect cinématographique ; il traite d'un sujet brûlant d'actualité et ne peut pas laisser indifférents les chrétiens que nous sommes.
Pierre Nambot
haut

Dunia
Un film de Jocelyn Saab Avec : Hanan Turk, Mohamed Mounir, Mohamed Mounir. Egypte, 2005 France 2006, 110 mn.
Étudiante en poésie soufie et en danse orientale au Caire, la jeune Dunia veut devenir danseuse professionnelle à l'instar de sa mère disparue. Au cours d'une audition, elle rencontre le Dr. Benshir, illustre homme de lettres. Son amoureux fait pression sur elle pour l'épouser et elle finit par accepter mais la tradition a détruit sa capacité au plaisir. Elle ne connaîtra cette sensation qu'après avoir découvert avec le Dr. Benshir le plaisir des sens tissé lui-même dans le plaisir des mots.
Jocelyn Saab construit son film autour d'une question très importante: comment une femme enfermée dans les traditions peut-elle analyser et comprendre le sentiment amoureux et ressentir un corps qu'elle dit ne "jamais avoir vu" et qui est amputé de sa partie la plus intime ?
Partant de cette interrogation, la réalisatrice s'appuie habilement sur les forces et les charmes de la culture égyptienne (la poésie soufie, la littérature, la musique et surtout la danse) et fait preuve d'une grande sensibilité pour capter la beauté qui en émane tout en suggérant les conséquences de certaines pratiques traditionnelles sans les réduire à de simples clichés (excision, condition des femmes…). Elle ne s'oppose pas frontalement à ces pratiques par des discours moralisateurs qui pourraient choquer les peuples concernés et n'a pas non plus recours au pathos exacerbé ou larmoyant à l'instar des occidentaux plutôt condescendants sur ce type de sujets.
Le film nous convie à un spectacle pudique où se mêlent danse, poésie, chant au cours duquel Dunia réussit l'éducation de ses sens atrophiés dès le plus jeune âge et découvre des sensations qu'elle ne pouvait imaginer. L'esthétisme très réussi des plans-séquences aux tons flamboyants donne un spectacle fait de grâce et de dynamisme sans jamais atténuer la gravité du sujet traité.
Dunia, qui veut dire « univers », s'inscrit dans l'action des cinéastes qui défendent les femmes en quête d'affirmation, comme c'est le cas de « Satin rouge » de Raja Amari ou « Fatma » de Khaled Ghorbal. Réalisé dans un pays où « les Mille et une Nuits » EST interdit pour érotisme, ce film en apparence inoffensif se révèle porteur d'un message « subversif » qui s'inscrit durablement dans les esprits. Pour les occidentaux, c'est une subtile introduction à la compréhension d'une culture terriblement réduite par les médias. Le film a été sélectionné au Festival des Films du Monde à Montréal, au Sundance Film Festival, au Festival des Films de Fribourg.
C'est une réussite qui mérite une attention toute particulière.
Pierre Nambot
haut

Je vais bien, ne t'en fais pas.
Réalisé par Philippe Lioret, avec Mélanie Laurent, Kad Merad, Julien Boisselier, Isabelle Renauld, Aïssa Maïga, Simon Buret. Durée : 1h40.
Ce film est tiré du roman éponyme d'Olivier Adam, également coauteur du scénario.
Lili (Mélanie Laurent), jeune fille épanouie et rayonnante, revient d'Espagne. A son arrivée, ses parents (Kad Merad et Isabelle Renaud) lui apprennent la disparition de son frère jumeau, Loïc, suite, selon eux, à une violente dispute avec leur père. Elle tente, mais en vain, de joindre son frère. Elle s'inquiète car ce n'est pas dans les habitudes du jeune homme de la laisser sans nouvelles. Après quelques semaines, elle est persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose et cherche à savoir ce que lui cachent ses parents. Touchée au plus profond d'elle-même, elle sombre dans la mélancolie au point de se laisser dépérir et d'être internée dans un hôpital psychiatrique. Un jour elle reçoit une lettre de Loïc…
Lioret aborde une problématique émanant de la structure familiale : les difficultés à communiquer, l'incapacité à manifester son affection, par pudeur, timidité ou parfois même par manque de générosité. Il met en scène des personnages qui, emmurés dans les non-dits et la douleur, pourraient être nos parents, nos frères, nos sœurs. Il tient le spectateur en haleine avec une dimension et une authenticité inattendues.
Le cinéma de Lioret illustre son sens aigu de l'observation du comportement de ses semblables (« Tenue correcte exigée » en 1997, « L'équipier »en 2001, « Mademoiselle » en 2004). En filmant les personnages au plus près, avec une très grande précision de mise en scène, c'est la vérité de la vie, de notre vie, qui survient et nous bouleverse. Le spectateur est dans l'attente d'une révélation qui sera finalement moins surprenante que les péripéties qu'il a suivies et en quelque sorte subies.
Mélanie Laurent, que nous avons remarquée dans « Le Dernier jour » puis dans « De battre mon cœur s'est arrêté », incarne avec force une Lili accablée par la souffrance ou rayonnante de bonheur. Kad est surprenant dans un rôle de composition aux antipodes de sa personnalité: renfermé et habillé de l'uniforme « costume cravate ». Il interprète avec une vérité saisissante un homme simple à qui le destin fait endosser une responsabilité exceptionnelle.
Un très beau film qui donne toute l'immensité incommensurable de l'amour que peuvent éprouver des parents envers leurs enfants.
Pierre Nambot
haut

La rentrée du cinéphile
Nausicaa de la vallée du vent, Réalisé par Hayao Miyazaki, Japon, 1984 - 2006, durée 116 mn.Les vacances sont terminées et pour beaucoup le rythme habituel de la vie reprend. Cet été, la canicule vous a peut-être incité à profiter des salles de cinéma pour trouver la fraîcheur et voir quelques uns des rares films intéressants qui passent encore, par exemple:
Pour une rentrée cinématographique plus en douceur, je vous propose un film d'animation de Hayao Miyazaki : Nausicaä de la vallée du vent. Le thème est relatif au devenir de notre planète. C'est très sérieux mais je pense que la forme avec laquelle il est traité vous permettra de ne pas puiser dans votre potentiel sérénité nécessaire à affronter les immanquables vicissitudes de la vie.
La réalisation de ce film sorti en 1984 au Japon mais seulement maintenant en France, est l'objet d'une longue histoire. Au début des années 80, la pollution de la Baie de Minamata amène Miyazaki à faire une œuvre environnementale en y associant des éléments d'un conte traditionnel qu'il affectionnait étant enfant ("La princesse qui aimait les insectes") et son aversion de la guerre et des superpuissances. Plus tard, il résume Nausicaä de la vallée du vent ainsi : "Il n'y a jamais eu une oeuvre d'art qui n'a pas reflété de quelque manière son époque... Nausicaä vient de la façon nouvelle dont on regardait la nature dans les années 70". Son 1er dessin animé ayant été un échec, les producteurs rejettent son projet de film. Faute de travail, il se lance dans la réalisation de la bande dessinée de « Nausicaä » sur laquelle il travaille pendant 13 ans (7 volumes, éditions Glénat). Entre temps un puissant éditeur le soutient ce qui va lui permettre de s'interrompre pour réaliser ses mangas qui ont tous connu un immense succès. Après Nausicaä de la vallée du vent (1984), il réalise Laputa - Le Château dans le ciel (1986), Mon voisin Totoro (1988), Kiki la petite sorcière (1989), Porco Rosso (1992), Princesse Mononoké (1997), Le Voyage de Chihiro (2001), Le Château ambulant (2004). Suite à des problèmes de distribution, Nausicaä ne nous parvient que maintenant ; c'est assez regrettable sur le plan chronologique car Miyazaki déclinera ses films à partir de cette oeuvre.
Le contexte du film nous est rapidement exposé dans le superbe générique où le feu se mêle à des ombres menaçantes et des dessins primitifs. Nous sommes dans un monde du futur où la terre a été ravagée en sept jours d'apocalypse par de gigantesques robots. Elle est alors devenue stérile, peuplée d'insectes mutants géants et couverte d'une forêt de plantes empoisonnées dont l'air vénéneux s'étend à mesure que ses spores se répandent dans l'atmosphère : c'est la Mer de la corruption. Seuls quelques groupes d'humains isolés les uns des autres survivent en essayant de se protéger. Nausicaä est la princesse d'un petit royaume vivant dans une vallée verdoyante et paisible préservée de la pollution et battue par les vents. Malheureusement la guerre oppose certaines communautés…Nausicaä va y mettre fin au péril de sa vie… C'est un personnage attachant, généreux et combatif. Elle est l'héroïne qui vient à bout de l'ennemi non par la force mais par la compréhension afin que celui-ci accepte de lui-même à vivre en harmonie avec les autres et la terre.
Le spectateur est pris entre la beauté éblouissante de la faune et la flore et la violence meurtrière. Mais il y a aussi l'ambivalence de cet écosystème où la nature tue mais aussi protège. La Mer de la Corruption empoisonne ceux qui s'y aventurent mais garantit également la pureté de l'air qui l'entoure. Le réalisateur ne s'arrête pas à une réflexion purement écologique, il s'interroge sur la nature profonde de l'homme qui, à l'instar de l'environnement, est à la fois créateur et destructeur.
Ce film est une allégorie qui transporte le spectateur dans un voyage initiatique à travers le monde en perdition. L'issue est christique et Miyazaki nous livre son propos messianique de façon à la fois simple et élaborée dans un cadre somptueux. C'est une merveille dans le fond et la forme.
Ne manquez pas ce chef d'œuvre qui vous permettra de faire une bonne rentrée cinématographique, C'est aussi un film pour enfants dont la lecture, évidemment différente pour eux, sera très édifiante.
Nos jours heureux
Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache, avec Jean-Paul Rouve, Marilou Berry, Omar Sy de 2006, durée 1h 43.
Quittons le premier semestre 2006 dans la joie et la bonne humeur, allons voir un film léger (une fois n’est pas coutume) et mettons nous dans l’ambiance des vacances, plus précisément des colonies de vacances.
Nous suivons avec un intense plaisir la vie d’un groupe. Nous retrouvons les errements qui caractérisent la jeunesse. C’est une « rigolade » permanente faite de situations complexes et incongrues que la vie en communauté apporte chaque jour.
Les enfants sont vraiment insupportables, les « monos » tout sauf responsables, mais ce petit monde apprend à se gérer. Le film montre, sans jamais se prendre au sérieux, une école de la vie ou enfants et adultes apprennent ensemble ce que sont les difficultés relationnelles. Comment répondre avec un sourire à toutes les urgences ? Comment le groupe peut-il venir au secours d’un être isolé, envahi par la mélancolie et la peur ? Les spectateurs chrétiens vont remarquer tout particulièrement cette monitrice « coincée » qui chante le cantique 601 (Trouver dans ma vie ta présence) pour distraire le groupe au cours d’un voyage en car ! Elle finit par se libérer au point d’utiliser un langage cru que personne n’égale.
En résumé on s’amuse à la colo, on fait ce qui plait, les temps forts se succèdent en permanence, seul le présent compte. Ainsi s’écoulent les jours heureux ! Les gens qui ont fait des colos savent que c’est « l’après » le plus difficile…
Toledano et Nakache se sont connus au gré des colonies de vacances où ils furent animateurs puis directeurs, nous livrent ici une œuvre amusante qui a aussi une réelle valeur documentaire. Les acteurs sont excellents, en particulier Jean-Paul Rouve et Marilou Berry.
Si vous souhaitez passer un excellent moment de détente, allez voir ce film et n’oubliez pas les enfants !
A toutes et à tous, je souhaite de bonnes vacances et à la rentrée !
Pierre Nambot
haut

Bled number one
Réalisé par Rabah Ameur-Zaïme (France – Algérie) avec Meriem Serbah, Abel Jafri, Rabah Ameur-Zaïmeche, Ramzi Bedia…DE 2006, durée : 1h40.
À peine sorti de prison, Kamel est expulsé de France vers son pays d’origine, l’Algérie. Il revient au bled et se trouve confronté aux réalités de son pays qui est tiraillé entre un désir de modernité et le poids des traditions.
Kamel, interprété par le réalisateur Rabah Ameur-Zaïmeche, est silencieux et se met en retrait d’une vie qui lui est presque inconnue. Il découvre les rites religieux et festifs ancestraux, se trouve face aux principes d’une société patriarcale mais aussi, malheureusement, aux exactions des bandes armées intégristes. Se sentir comme un étranger en Algérie, connaître de manière impromptue les joies d’une fraternité chaleureuse puis les peines d’une violence exacerbée et inégalitaire lui met les nerfs à fleur de peau. Kamel est désorienté mais il n’est pas seul. Il rencontre Louisa qui a fui le domicile conjugal avec son fils, chassée par sa mère, battue par son frère pour avoir humilié et déshonoré la famille.
Le réalisateur a tourné ce film dans le village où il est né et où habite encore une partie de sa famille issue d'une tribu berbère. Dans la première partie, il satisfait pleinement le spectateur curieux qui vit le charme de l’ambiance du bled: musique, accolades, thé pris sur la terrasse… Ensuite le film bascule dans une fiction décevante car déjà vue et mieux traitée par d’autres cinéastes, par exemple l’idée du barrage filtrant a été autrement mieux exploitée par Suleiman dans Intervention divine. Cette volonté de nous faire partager un quotidien aurait pu prendre une ampleur différente car l’histoire manque de profondeur.
Néanmoins Rabah Ameur-Zaïme a le mérite de nous montrer avec beaucoup de sensibilité et peu de moyens, cette fatalité de l'exil et la responsabilité pesante du monde sur des individus seuls et démunis.
Pierre Nambot
Précédents articles sur un film
| Bienvenue |
|
| |
| Numéros en ligne |
|
|
| |
