|

Numéro 196
Février 2006
 Sommaire & Résumés
Sommaire & Résumés
( : permet d'aller au corps de l'article)
: permet d'aller au corps de l'article)
Éditorial
Bible et démocratie,
par Laurent
Gagnebin,
Traduire la Bible dans une langue
accessible à tous, comme le fit Luther à partir de
1521, fut à bien des égards un geste révolutionnaire.
Le clergé se trouva en effet dépossédé
d’un pouvoir et d’un privilège : celui d’une
lecture et d’une interprétation exclusives des Écritures.
L’autorité de la Bible ne dépendra plus dorénavant
des... autorités religieuses... 
 haut haut 
Questionner
Le même mot « libéralisme », étroitement
associé au mot « liberté », est utilisé
pour désigner à la fois un comportement économique,
et une attitude envers la religion. Vincens Hubac nous rappelle
que ces deux façons de penser ont une origine commune,
liée à la Réforme et à la Révolution
française.
Le Libéralisme,
par Vincens Hubac
Le mot « libéralisme
», apparu en 1823, est un mot de combat au service de la cause
pour la liberté politique et économique. Le XIXe siècle
est celui des révolutions, des nationalités et de
la démocratie. Il est aussi celui d’une expansion sans
précédent de l’Occident. Mais déjà
le mot ne définit plus ce qu’il aurait dû être... 
 haut haut 
Réagir
On peut percevoir un écho mutuel des plaintes des
jeunes qui se sont soulevés dans les banlieues et de
celles, moins audibles celles-là, des jeunes du continent
noir. De la flambée des banlieues de Paris au sommet
franco-africain de Bamako, début décembre, comment
ne pas entendre les mêmes signes, les mêmes indices,
qui sont ceux d’un évident décalage ?
Jeunes des banlieues,
jeunes Africains : même désespoir , par Antoine
Bosshard
Tout au long de l’automne,
la France aura été secouée par une rébellion
des banlieues dont seule l’intensité était nouvelle.
Et marquée par les propos violents d’un ministre de
l’Intérieur pour certains jeunes des banlieues (mais
tous se sont sentis visés), parlant de « racaille »
et de recours au « karcher ». On en connaît les
effets... 
 haut haut 
Ces mots qu'on n'aime pas
Colère de Dieu,
par Bernard Félix
La Bible, particulièrement
dans le livre des Psaumes, fourmille de passages qui appellent la
colère de Dieu contre les méchants qui nous oppriment.
Et, par voie de conséquence, s’installe chez les fidèles
une profonde crainte de cette colère... 
 haut haut 
Carte blanche
Causalité et
but, par Olivier
Pigeaud
En lisant la récente édition
moderne du Nouveau Testament de Lefèvre d’Étaples
(1525) mon attention a été attirée par deux
passages : « Et il ne fit là guère de miracles,
pour leur incrédulité » Mt 13,58. Et : «
Pour ce que personne ne nous a loués » Mt 20,7. En
français d’aujourd’hui, on aurait écrit
« à cause de… » ou « parce que….
» De fait, à la lecture de certains textes bibliques,
on se demande parfois si le lien entre deux propositions est de
l’ordre de la cause ou de la conséquence.... 
 haut haut 
Série : la foi
1. Foi ou croire,
par André
Gounelle
Le théologien zurichois
G. Ebeling aurait dit, un jour : « On ne devrait pas dire
“j’ai la foi”, mais “je crois”. »
Ne croyez pas qu’il s’agisse là d’arguties
d’intellectuels et qu’utiliser un substantif ou un verbe
revient au même.
Le nom convient mal parce qu’il favorise un malentendu. En
principe, les substantifs désignent des objets. Or ce qu’on
a l’habitude d’appeler « foi » n’est
pas une chose qu’on détient, qu’on perd, qu’on
retrouve, qu’on transmet, comme un trousseau de clefs ou un
porte-monnaie... 
 haut haut 
Billet
 Le
méchant bon Dieu, par Henri
Persoz Le
méchant bon Dieu, par Henri
Persoz
Nous visitions, avec des amis,
la cathédrale de Reims. Des petits boîtiers avec écouteurs
nous ont permis de bénéficier de commentaires avisés.
Grâce à eux, notre attention était attirée
sur nombre de détails qui seraient passés inaperçus
autrement. Synergie entre la technique électronique d’aujourd’hui
et les techniques architecturales du Moyen Âge. Aperçu
aussi sur la théologie de l’époque, sur ce que
l’Église voulait enseigner au peuple... 
 haut haut 
Commenter
Ces versets précèdent ce que nous appelons
de décalogue. Curieusement, ils introduisent le lecteur
à la loi de Dieu en exprimant deux mensonges. Ils montrent
que la Bible peut contenir des contradictions manifestes sans
que cela remette en cause son message, sauf à penser
qu’elle est un manuel d’histoire.
Deux mensonges pour
rappeler deux vérités, de James
Woody
 Première
surprise : Moïse dit aux Hébreux que ce n’est pas
avec leurs pères que l’Éternel a conclu une alliance
mais avec le peuple qui est là. C’est beau, mais c’est
faux ! Lorsque Moïse parle, c’est quarante ans après
la sortie d’Égypte (Dt 1,3), période pendant
laquelle sont morts beaucoup d’adultes sortis d’Égypte,
qui ont été avec Moïse au pied du Sinaï
mais qui, par leur révolte, ont été interdits
de terre promise... Première
surprise : Moïse dit aux Hébreux que ce n’est pas
avec leurs pères que l’Éternel a conclu une alliance
mais avec le peuple qui est là. C’est beau, mais c’est
faux ! Lorsque Moïse parle, c’est quarante ans après
la sortie d’Égypte (Dt 1,3), période pendant
laquelle sont morts beaucoup d’adultes sortis d’Égypte,
qui ont été avec Moïse au pied du Sinaï
mais qui, par leur révolte, ont été interdits
de terre promise... 
 haut haut 
Cahier : Robinson Crusoé, un mythe
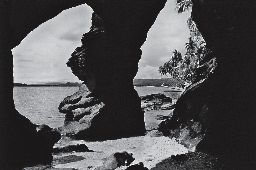 Le
roman de Daniel Defoe, publié en 1719, a été
traduit dans presque toutes les langues, y compris le copte et
l’esquimau. C’est le livre qui a eu le plus grand nombre
d’éditions après la Bible. Jean-Jacques Rousseau
a chanté les louanges du roman « qui sera tout à
la fois l’amusement et l’instruction d’Émile
». Un siècle et demi après sa parution Offenbach
en a tiré un opéra et Marx le substantif «
robinsonnade », passé ensuite dans le vocabulaire
des littéraires et des économistes. Le genre littéraire
a été exploité par de nombreux auteurs de
Jules Verne à Michel Tournier. Le
roman de Daniel Defoe, publié en 1719, a été
traduit dans presque toutes les langues, y compris le copte et
l’esquimau. C’est le livre qui a eu le plus grand nombre
d’éditions après la Bible. Jean-Jacques Rousseau
a chanté les louanges du roman « qui sera tout à
la fois l’amusement et l’instruction d’Émile
». Un siècle et demi après sa parution Offenbach
en a tiré un opéra et Marx le substantif «
robinsonnade », passé ensuite dans le vocabulaire
des littéraires et des économistes. Le genre littéraire
a été exploité par de nombreux auteurs de
Jules Verne à Michel Tournier.
Comment comprendre d’une part le succès immédiat
de cette oeuvre et d’autre part que ce succès ait
perduré au cours des siècles ?
Daniel Defoe, né à Londres en 1660 était
homme d’affaires, journaliste, pamphlétaire et homme
d’action avant d’être romancier. Il avait des
positions politiques affirmées et courageuses ; presbytérien,
il avait été éduqué au respect des
règles et des valeurs morales d’avantage qu’au
culte de l’argent.
Daniel Defoe s’est inspiré pour son récit
de l’aventure authentique d’un marin écossais,
Alexander Selkirk, qui vécut quatre ans sur l’île
inhabitée de Juan Fernandez, au large des côtes chiliennes.
Robinson Crusoé exprime les idées, les aspirations
et les craintes des lecteurs qui l’ont découvert ;
depuis le XVIIe siècle, un individu autosuffisant, actif,
productif constituait un modèle culturel. Robinson pratiquait
le commerce clandestin des Nègres ; pourquoi cet homme
d’affaires ambitieux, banal et médiocre est-il devenu,
pour des générations de lecteurs, un symbole, un
mythe ? Sans doute parce que le lecteur ne retient que l’aventure,
le mystère, l’île déserte, l’angoisse
existentielle ; il découvre un homme obligé pendant
de longues années à ne dialoguer qu’avec lui-même
et à trouver, dans le travail et dans la foi, la force
de vivre et de lutter victorieusement contre la mort.
De nos jours, l’île déserte apparaît
comme un endroit idéal, un petit paradis terrestre, un
coin de la planète où persiste le souvenir d’une
nature vierge et indomptée. C’est alors la quête
des origines qui permet au lecteur de s’identifier au héros.
Mais le roman, souvent classé à tort dans la
littérature pour la jeunesse, est en réalité
un ouvrage pour adultes, qui est d’abord le récit
d’une conversion. Bernard Reymond montre ici l’importance
du protestantisme dans ce récit, tout en soulignant que
le protestantisme de Robinson est celui du Siècle des Lumières
qui veut concilier foi et raison et faire place à la liberté
de pensée.
Bernard Reymond est professeur honoraire de théologie
pratique à l’Université de Lausanne. Il est
spécialiste des relations entre culture et foi chrétienne
et auteur de nombreux ouvrages.  Marie-Noële et Jean-Luc Duchêne.
Marie-Noële et Jean-Luc Duchêne.
Le protestantisme
de Robinson Crusoé par Bernard
Reymond 
 haut haut 
Vivre
J’ai perdu mon
doudou !, par Martine
Millet
J’avais décidé
de ne pas me faire avoir… Et puis la mode m’a rattrapée.
Besoin d’être en relation, d’avoir une grande tribu,
un clan, une famille au-delà des frontières. J’ai
eu aussi besoin d’un doudou… bien calé dans ma
main, bleu et orange, raffiné, délicat, sobre !... 
 haut haut 
Débattre
L’entrée de la Turquie dans l’Union européenne
reste une source de discussions souvent vives. Un de nos lecteurs
s’interroge sur la position que Claudine Castelnau a exprimée
en décembre sur ce sujet. Et Claudine Castelnau lui répond.
La Turquie et l’Europe,
par Jean-Robert
Charles et Claudine
Castelnau
Je lis toujours avec beaucoup d’intérêt
votre bonne revue Évangile et liberté dont la liberté
de ton me plaît... Toutefois je m’interroge au sujet
de la page « En bref » (n° 194 de décembre
2005) rédigée par Claudine Castelnau, plus particulièrement
dans les colonnes consacrées à la Turquie («
Les chrétiens turcs et l’Europe » et « Nos
racines chrétiennes sont en Turquie »)... 
 haut haut 
Dialoguer
 Françoise
Tomlin nous présente le mouvement Quaker dont elle fait
partie Françoise
Tomlin nous présente le mouvement Quaker dont elle fait
partie
La nature divine de
l’homme, par Françoise
Tomlin
Notre principale caractéristique
? Nous affirmons que toute personne, au plus profond d’elle-même,
est de nature divine, même si, en certains cas, cela est fort
bien caché !... 
 haut haut 
Agir
Pour changer la société, faut-il attendre d’avoir
changé l’individu ? À trop espérer d’un
seul objectif, on risque de tout perdre !
Changer quoi ? Changer
qui ?, par Guy
Bottinelli
Jamais comme en ces temps où
tant de choses changent… l’appel au changement n’a
été aussi fort. Tous les jours qui passent, il est
question de réforme : de l’école, du système
de santé, de l’État. Tout dépend des terrains
considérés, suivant qu’il s’agisse des valeurs
(famille, démocratie, laïcité) qu’on souhaite
consolider, ou de conditions de vie, de justice dans les rapports
internationaux, qu’il est urgent de faire évoluer... 
 haut haut 
Retrouver
 Écrivain
et figure emblématique du romantisme, homme politique connu
pour ses idées libérales, Benjamin Constant (1767-1830)
est aussi l’auteur de De la religion. Cette vaste réflexion
sur l’histoire des religions, moins connue que son roman
Adolphe, est pourtant la grande œuvre de sa vie. Écrivain
et figure emblématique du romantisme, homme politique connu
pour ses idées libérales, Benjamin Constant (1767-1830)
est aussi l’auteur de De la religion. Cette vaste réflexion
sur l’histoire des religions, moins connue que son roman
Adolphe, est pourtant la grande œuvre de sa vie.
Benjamin Constant,
par Geoffroy
de Turckheim
Connu pour avoir été
à la fois l’un des chantres du romantisme et de la démocratie
libérale, Benjamin Constant l’est beaucoup moins pour
ses travaux sur l’anthropologie religieuse, discipline dont
il est d’une certaine façon le créateur et qui
aura été la grande passion de sa vie. Dès l’âge
de 18 ans, il décide de s’atteler à cette question
qui le hante depuis longtemps : pourquoi, au cours de sa longue
histoire, l’être humain a toujours été
habité par ce qu’il appelle le « sentiment religieux
» ? ... 
 haut haut 
Lire
Livre : Conférences de l'Étoile

Livre : Aux origines d’Israël

Livre : Former une famille recomposée
heureuse

 haut haut 
|

Pierre Soulages,
Gouache 2004-88.
© ADAGP, Paris, 2006
|
Résonner
Le protestantisme, la foi insoumise, de L. Gagnebin et R.
Picon, paru récemment chez Flammarion, est illustré
sur sa couverture par une gouache inédite de Pierre Soulages.
Raphaël Picon nous explique comment l’œuvre de
ce peintre le renvoie à Dieu.
Outre-Noir, par
Raphaël Picon
Deux récentes expositions
proposées par la galerie Robert Miller de New York présentaient
récemment les derniers travaux du peintre français
Pierre Soulages, les regroupant dans deux séries intitulées
respectivement « Outre-noir » et « Au-delà
du noir ». Ces titres évocateurs disent d’eux-mêmes
la profondeur et l’intensité de cette œuvre singulière,
exigeante et pourtant si limpide et immédiate... 
 haut haut 
Nouvelles
Penser sa foi : un recueil d'André Gounelle

Concours 
Les week-end de l’étoile 
Questionnaire 
 haut haut 
Courrier des Lecteurs
Évangile
& liberté comprend une page entière
consacrée au Courrier des lecteurs. Nous voulons ainsi une
page vive, animée, publiant librement vos réactions
à tel ou tel article. 
 haut haut 
Citation
Il est absolument
impossible de vouloir imposer à quelqu’un telle ou telle
croyance. Chacun n’est responsable que devant sa conscience de
croire ou de ne pas croire...
Car la foi est une chose absolument libre, on ne peut y forcer personne.
Martin Luther, De l'autorité temporelle.
 haut haut 
Merci de soutenir Évangile & liberté
en vous abonnant :)
|

|
|


