|

Numéro 205
Janvier 2007
 Sommaire & Résumés
Sommaire & Résumés
( : permet d'aller au corps de l'article)
: permet d'aller au corps de l'article)
Éditorial
Union et non pas unité,
par Laurent
Gagnebin
Du 18 au 25 janvier a lieu, comme chaque année, la «
semaine de prière pour l’unité des chrétiens
». Faut-il encore parler d’unité ? Nos contemporains
attendent simultanément de nous des convictions fortes, qui
tranchent avec les théologies passe-partout, et un esprit
de dialogue, qui ne se ferme pas aux autres spiritualités...

 haut haut 
Questionner
L’affaire déjà relativement ancienne
des fameuses caricatures de Mahomet ne s’est pas limitée
à une opposition entre liberté de la presse et
respect des traditions religieuses. Elle nous pousse à
approfondir la question de l’interdit de la représentation.
Tu ne te feras pas
d’idole, par Gilbert
Carayon
Depuis que l’homo sapiens a pris conscience qu’il était
dominé par les forces de la nature, il a été
tenté de représenter ces forces, afin sans doute de
pouvoir entrer plus facilement en contact avec elles, dans le but
de les rendre favorables à l’homme par le biais de la
prière et des rites. À partir de cette hypothèse,
d’autres facteurs entrent en jeu pour tenter d’expliquer
la présence ou non de représentations du divin...
 haut haut 
Débattre
À l’occasion de la parution récente de
deux publications, André Gounelle précise l’état
des divergences et convergences de vue, théoriques et
pratiques, des catholiques et des protestants sur la cène.
La cène : avancées
œcuméniques, par André
Gounelle
La cène ou eucharistie a toujours opposé catholiques
et protestants. Au dix-septième siècle, en France,
97 % des livres de controverse entre les deux confessions en traitent,
et il ne reste que 3 % pour les autres sujets de désaccord
(la Bible, la grâce, Marie, le pape). La querelle se centre
sur la doctrine de la transsubstantiation (changement de la réalité
du pain et du vin en corps et sang du Christ) affirmée par
le Concile de Trente (convoqué dans la ville italienne de
Trento par le pape Paul III en 1545), catégoriquement rejetée
par les réformés qui y voient une idolâtrie
puisqu’elle entraîne la divinisation de l’hostie
consacrée. Aujourd’hui encore, dans les relations œcuméniques,
la cène reste une pomme majeure de discorde et malgré
de nombreux efforts, on n’arrive pas à rapprocher les
points de vue. Le débat porte principalement sur l’hospitalité
eucharistique : une Église peut-elle inviter les fidèles
d’une autre Église à sa table de communion, sans
leur demander, pour cela, de renier leurs convictions propres ?...
 haut haut 
Ces mots qu'on n'aime pas
Mystère,
par Laurent
Gagnebin
La naissance virginale ? Un mystère. Jésus
marche sur les eaux ? Un mystère. Le tombeau vide ? Un mystère.
La présence réelle du Christ dans le pain et le vin
de la cène ? Un mystère. On pense au faux médecin
du Malade imaginaire, invoquant invariablement « le poumon
» pour cause des maux au sujet desquels Argan l’interroge.
Ce « mystère » n’est-il pas le cache-misère
de théologies infantilisantes ? Le plus incroyable, le plus
absurde, le plus contraire à la raison ou à la simple
intelligence, au lieu d’être désigné comme
tel, se voit promu au rang si beau, mais exceptionnel, du mystère...

 haut haut 
Série : les lamentations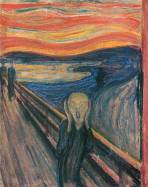
« Rends-leur ce qu’ils m’ont fait Seigneur.
Ferme leur cœur.
Ce sera la malédiction sur eux !
Poursuis-les avec colère et chasse-les de la terre !
»
Lm 3,64-66
4. Voici l’Homme
! Voici la souffrance de Dieu, par Florence
Taubmann
Choqués par les propos violents contre les ennemis, nous
opposons souvent le Dieu du Premier Testament et celui de l’Évangile.
L’un pousserait la justice jusqu’à la vengeance
; l’autre ne serait qu’amour et miséricorde. Pourtant,
« c’est seulement quand on admet la colère et
la vengeance de Dieu envers ses ennemis comme des réalités
valables que l’on peut pardonner et aimer ses ennemis. Celui
qui veut immédiatement passer au Nouveau Testament n’est
pas chrétien à mon avis », écrit Dietrich
Bonhoeffer dans Résistance et soumission...

 haut haut 
Billet
Cloisons mentales,
par Robert
Philipoussi
Au moment où il devient de plus en plus clair pour de plus
en plus de monde que la conscience, l’organisation, la socialité,
la projection vers l’avenir, la ritualité, l’intelligence
en somme ne sont plus et n’ont jamais été l’apanage
de l’espèce humaine, que disent les Églises et
leurs théologiens ? Rien. On refuse de voir que Dieu est
une métaphore de l’humain, que l’humain a fait
Dieu à son image idéalisée, jusqu’à
ce que cet humain devienne dieu en Jésus (sans que ce dernier
ait été consulté). Bientôt, il faudra
déclarer la pensée chrétienne autiste... 
 haut haut 
Méditer
In memoriam Geoffroy
de Turckheim
Quand je dormirai du sommeil qu’on nomme la mort,
c’est en toi que j’aurai mon repos...
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la
mort, le 27 novembre 2006, du pasteur Geoffroy de Turckheim...
 haut haut 
Cahier : Jésus-Christ et les religions non-chrétienne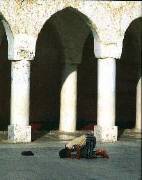
Depuis de nombreuses années des théologiens
cherchent à repenser la foi chrétienne à
la lumière des questions que leur pose la prise en compte
de la pluralité des religions. Comment peut-on être
chrétien dans un contexte marqué par une très
forte diversité religieuse ? Comment peut-on croire au
Dieu révélé en Jésus-Christ tout en
considérant les autres religions comme étant légitimes
sur un plan théologique ? Un dialogue particulièrement
vif oppose aujourd’hui les adeptes d’une conception
pluraliste de la foi chrétienne et du Christ à ceux
qui en proposent une approche délibérément
relativiste. 
Jésus-Christ
et les religions non-chrétienne, par Raphaël
Picon
Comment croire conjointement au Christ et en un Dieu qui se révèle
là où ce même Christ n’est pas nommé
et vénéré ? Comment penser que les autres religions
ne transmettent pas seulement un enseignement sur Dieu, mais qu’elles
contribuent à révéler ce dernier ? Ces questions
sont directement impliquées par l’idée assez
communément admise, selon laquelle aucune foi en Dieu ne
serait vraiment possible en dehors de la référence
à Jésus-Christ. La Bible elle-même, dans son
Évangile de Jean, ne fait-elle pas dire à Jésus
: « Nul ne vient au Père si ce n’est par moi »
?...
 haut haut 
Vivre
Le petit-fils de Simon,
par Bernard Félix
Veuf et handicapé, Simon vit seul dans sa grande maison
et s’en tire assez bien grâce à quelques voisins
et à une aide-ménagère. Il se dit heureux de
recevoir ma visite régulièrement et nous bavardons
longuement de sa vie. Dans sa déchéance relative,
il ne parvient pas à bien sentir cette part de bonheur qui
fut la sienne et dont je souhaiterais qu’il garde le chaud
souvenir...
 haut haut 
Commenter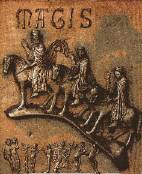
Trop connue est cette histoire de mages racontée par
Matthieu. Mais les commentaires n’insistent pas trop sur
ceux qui ne sont pas venus au rendez-vous de l’histoire :
les prêtres. Ne serions- nous pas comme eux ? À vouloir
rester chez nous, plutôt que de marcher avec les mages païens
et d’aller avec eux au devant du Messie ?
Un rendez-vous manqué
(Mt 2,1-12), par Henri
Persoz
Ces mages étaient sans doute des savants, persans ou arabes,
païens certes, mais intéressés par le messianisme
juif. Plus qu’intéressés puisqu’ils voulaient
venir se prosterner devant ce Fils de l’homme qui arrivait
en ce monde. L’étoile leur avait bien dit qu’il
venait de naître, mais ne leur avait pas dit où. Il
était en effet courant, dans la culture de l’époque,
que la naissance des grands personnages soit saluée par l’apparition
d’une nouvelle étoile. Les mages entreprirent donc le
grand voyage jusqu’à Jérusalem pour demander
au roi Hérode le lieu de la naissance du héros. Le
roi, ne sachant pas, se retourna vers les prêtres et les scribes.
Ceux-ci savaient par l’Écriture où le Messie
devait naître, mais ne savaient pas quand. Chacun disposait
donc d’une partie de l’énigme, mais insuffisante,
à elle seule, pour trouver le nouveau-né...
 haut haut 
Dans le monde et dans les Églises
par Claudine
Castelnau
États-Unis
: Quelle place pour la religion ? 
Inde : Non
aux « sonneries musulmanes » des mobiles 
Scientologie
: Combien de divisions ? 
Pakistan :
La minorité chrétienne inquiète 
 haut haut 
 Commémorer Commémorer
Le Centenaire du Foyer
de l’Âme
Le dimanche 17 mars 1907, le pasteur Charles Wagner inaugurait
à Paris le nouveau temple du Foyer de l’Âme qu’il
avait enfin réussi à faire construire grâce
à une solide détermination. Arrivé à
Paris 25 ans plus tôt, pour tenter de tonifier le «
parti libéral » il eut bien du mal à se faire
admettre au sein des Églises protestantes établies
et finit par constituer progressivement sa propre paroisse dans
différents locaux de fortune, à chaque fois un peu
plus grands. La construction du temple du Foyer de l’Âme
donnait au protestantisme libéral parisien la possibilité
de s’épanouir dans une paroisse précise. On comprend
que celle-ci ait toujours cultivé des liens étroits
avec Évangile et Liberté.
Pour fêter ce centenaire, toute l’année 2007
sera marquée par des manifestations concernant le souvenir
de ces années pionnières et le développement
ultérieur du mouvement libéral. 
 haut haut 
Retrouver
Considéré comme le père de notre pédagogie
moderne mais étonnamment peu connu, Pestalozzi (1746-1827)
est un chrétien brûlant d’action qui, toute
sa vie, a cherché comment donner à chacun les moyens
de sa propre liberté.
Johann Heinrich Pestalozzi,
par Robin Sautter
Johann Heinrich Pestalozzi est né à Zurich. Orphelin
de père à 12 ans, il lui arrive d’accompagner
son grand-père pasteur. Au cours de ces visites, il découvre
le sort réservé aux gens des campagnes, exploités
par les villes et leurs industries en plein développement.
C’est là qu’il fait le vœu de consacrer sa
vie à lutter contre les injustices sociales...
 haut haut 
Regarder
Une aube nouvelle

Jorma Puranen, Icy
Prospect 21. Photographie, 2005.
Reproduit avec l’aimable autorisation de l’artiste. 
 haut haut 
Lire
Livre : Existe-t-il une spiritualité
sans Dieu ? 
Livre : Jésus-Christ, de quoi
est-on sûr ? 
Livre : La Vierge Marie 
 haut haut 
Résonner 
La naissance de Jésus est un événement
qui fait plus appel à la foi qu’à la raison.
Pourtant, devant ce tableau, Jean-Marie de Bourqueney admire la
façon dont Botticelli met autant en valeur la raison que
la foi.
La foi et la raison,
par Jean-Marie
de Bourqueney
(à propos de l’Adoration des Mages, par Sandro Botticelli,
1475, Florence, Galerie des Offices)
Nous sommes à Florence en 1475. La cité de l’Arno
est en ébullition. Sous la houlette de la famille Médicis,
notamment de Laurent le Magnifique, peintres, philosophes, sculpteurs,
théologiens travaillent ensemble. C’est l’ère
de la créativité ! Des noms et des génies se
rencontrent : Pic de la Mirandole, Filippo Lippi, Marsile Ficin,
Sandro Botticelli. Les manuscrits de Platon ont été
redécouverts il y a quelques années. Tous y voient
un chemin : celui de la Renaissance. Enfin réconcilier l’Antique
et le Biblique, la philosophie et la théologie, la raison
et la foi...
 haut haut 
Nouvelles
Livre en souscription 
Dépliant 
Site internet d'Évangile et liberté 
 haut haut 
Courrier des Lecteurs
Évangile
& liberté comprend une page entière
consacrée au Courrier des lecteurs. Nous voulons ainsi une
page vive, animée, publiant librement vos réactions
à tel ou tel article. 
 haut haut 
Citation
Je ne crois pas qu’il
puisse y avoir sur terre une seule religion.
Mais si un homme atteint le cœur de sa propre religion,
il atteint également le cœur des autres religions.
Gandhi
 haut haut 
Merci de soutenir Évangile & liberté
en vous abonnant
:)

Vous pouvez nous écrire vos
remarques,
vos encouragements, vos questions 
|

|
|

